 | ♣_______Page mise à jour le 13 mars 2018 vers 07h40 TUC |
Quelques récits traduits de The Black Border
On trouvera dans cette page la traduction de quelques-uns des récits publiés par Ambrose Elliott Gonzales dans son livre The Black Border (que l'on peut lire et télécharger à cette adresse [⇒]).
Les textes du livre alternent – et parfois mélangent – l'anglais (introductions, commentaires, certains propos) et le gullah (majorité des dialogues, récits rapportés). Ci-dessous, la traduction de l'anglais apparaît en rouge brique, celle du gullah, dans la couleur orange habituelle.
Introduction
w sur la forme, son manque de rigueur (his fictionalized approximation of Gullah dialogue ).
On ne peut que respecter (y compris dans le sens où on respecte un règlement ) cette perception, mais ne pas la partager entièrement :
q s'il n'était pas un scientifique, Gonzales n'était pas non plus un humaniste : rien d'une Margaret Mead ou d'un Théodore Monod, pas d'empathie ni même de sympathie – mais la recherche du détail croustillant, du portrait qui fait mouche et (c'est du moins ce que j'ai ressenti en le traduisant), un goût prononcé pour l'ironie, ne reculant pas devant un certain cynisme à l'occasion d'un bon mot ou d'un petit morceau de bravoure, surtout si c'est aux dépens des autres – et, pour un planteur blanc, fils d'officier sudiste, les autres ont facilement la peau noire.
C'est dans cet esprit que ces textes ont été traduits – sans empathie non plus avec leur auteur, mais en lui reconnaissant un sens de la narration, de la mise en œuvre et de la dérision. En pensant alors moins à Maupassant qu'à Louis-Ferdinand Céline – celui du Voyage ou de Mort à crédit .
Le Pays gullah
 | Avec pour capitale Charleston, La Ville , et pour cœur le Bas Pays (Low Country ) autour de Beaufort et de Saint Helena, le Pays gullah comprend de nombreuses îles séparées de la côte ou entre elles par tout un réseau de rivières et de bras de mer. Son climat (propice à la culture du riz) et sa situation géographique en faisaient une région à part, relativement isolée, dont les habitantes étaient dans leur grande majorité d'origine africaine. NB1- Sur la carte aa les noms des villes sont indifféremment en rouge ou en violet. NB2- Placer le curseur sur la carte pour afficher les noms en gullah aa |   |
Quelques mots sur la langue gullah telle qu'elle est présentée dans The Black Border
- Son vocabulaire est d'origine anglaise, mais avec diverses simplifications phonétiques :
- remplacement de [ð] par d et de [θ] par t ;
- remplacement de diverses syllabes finales non accentuées (after, colour, fellow ) par [ə], écrit en général uh ;
- assimilation de certains groupes consonantiques (after a attuh, have to a haffuh)
Une page voisine [⇒] propose la traduction du lexique gullah rassemblé par Ambrose Gonzales.
- Sa syntaxe, en partie empruntée aux langues d'origine des esclaves, utilise une forme unique pour le singulier et le pluriel des noms ainsi que les personnes et temps des verbes ; par exemple, de medjuh peut être la ou les mesure[s], uh medjuh, je mesure ou j'ai mesuré, dem medjuh, elles/ils mesurent ou mesuraient, medjuhr'um, mesure[z]-les ou en les mesurant.
q Mon Monsieur | My Maussuh (pages 24 à 28) |
On doit pouvoir mesurer les bienfaits du système de l'esclavage sous de bons maîtres au fait que Joe Fields, un Noir aux yeux jaunes, aux genoux cagneux, aux pieds de travers, longtemps le mari de Philippa, pendant quelque temps père de jumeaux, vantait encore, cinquante-trois ans après la guerre (3), la valeur et les œuvres de son ancien maître (2b), Duncan Clinch Heyward (2a), un temps gouverneur de Caroline du sud, présentement collecteur des taxes locales et siégeant à la recette des douanes dans le haut bâtiment de Palmetto à Columbia, avec autorité sur la taxe de guerre, les surtaxes et tout autre impôt prélevé localement par un gouvernement bienveillant sur ses loyaux administrés (3). […] Lors d'une réunion récente de Noirs inoccupés, à la gare d'Adams Run, quelqu'un fut d'avis que le Président, bien que Dimicraque , devait être un type bien (5) pour avoir rallongé les jours pour les peaux sombres et emporté les chemins de fer. New York, dans l'esprit des Noirs de la Côte, est l'ultima Thule – à la fois l'extrême nord et le véritable cœur du Pays Yankee, là où, dans sa majesté impressionnante, le Président des États-Unis est supposé siéger comme Zeus sur l'Olympe, ou comme « mon Monsieur » (5) à Columbia (6). « Oui, mon gars » dit Joe « le Président (7) est un type bien, c'est sûr, mais pas aussi bien que Monsieur, parce que mon Monsieur a dû aller à New York (8) pour dire au Président ce qu'il devait faire. Pareil que monsieur dit à M. Jaycocks (9) (celui qui surveille la région de la Combahee) combien de riz et de tout il faut planter, pareil il a dit au Président quoi faire, et le Président a été assez bien pour le faire. Alors Monsieur croise les jambes et réfléchit encore. Il trouve une nouvelle ruse ! Monsieur le remercie pour la loi qu'il a faite, mais lui dit qu'une chose qui l'ennuie est le chemin de fer qui va de White Hall (18) à Charleston. Il lui dit que tous les samedis, la gare de White Hall est remplie de Noirs qui vont à la ville dépenser leur argent. Monsieur lui dit que le billet et le trajet ne sont pas assez chers, et que, si le Président lui donnait le chemin de fer, il augmenterait le prix du billet, et ainsi, les Noirs ne pourraient pas voyager aussi facilement. Le Président lui dit que oui, c'est un très bon plan, mais qu'il a un gendre très habile pour soutirer de l'argent aux Blancs et que, s'il peut soutirer de l'argent aux Blancs, il peut en soutirer aux Noirs tout aussi bien ; il dit qu'il prendra le chemin de fer aux Blancs et le donnera à son gendre (19) ; et monsieur lui dit que c'est très bien, qu'il est d'accord avec lui pour ça, et alors monsieur rentre chez lui, et écrit une lettre à M. Jaycocks pour lui dire de faire travailler les Noirs une heure de plus chaque jour que Dieu fait, et M. Jaycocks transmet le message ; et, avec l'aide de Dieu, le gendre du Président fait payer plus cher les Noirs pour prendre le train, et tout le monde dit que le Président est un type bien d'avoir fait la loi mais, dites-moi, c'est mon Monsieur qui a fait faire la loi par le Président ! Il est rusé, pour tout organiser pour que le Président et lui n'aient pas à travailler ! Mon Monsieur n'est pas fait pour travailler. Non, monsieur ! » |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Notes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il est évident que Joe prête à Heyward le réflexe de crainte qui lui ferait fermer les yeux, à lui, Joe ; mais n'est-ce pas plutôt (et plus tôt , dans la chronologie de l'écriture du livre) Gonzales qui prête ce réflexe à Joe ?
- Quelques constats :
- évident – c'est Joe Fields qui parle ;
- tout aussi évident – ledit Joe n'assistait pas à la scène qu'il raconte ;
- hautement probable – Duncan Heyward ne lui en a pas fait le compte-rendu, et Joe n'en a pas eu le récit même de deuxième ou de troisième main ;
- vraisemblable, donc – Joe imagine les propos tenus par Thomas Wilson et Heyward.
- Mais reportons-nous aux faits réels, tels qu'ils sont consignés dans la page de WikiMonde consacrée à l'USRA [⇒], qui
est le nom donné à la nationalisation des chemins de fer des États-Unis qui eut lieu entre 1917 et 1920. […] Le 21 mars 1918, le Railway Administration Act est mis en vigueur et l'ordre de nationalisation décidé par le président Wilson en 1917 est confirmé. Wilson nomme son gendre William Gibb McAdoo, Secrétaire au Trésor, directeur général de la nouvelle USRA .
[…] Les salaires et les taux pour les transports des passagers et des marchandises de l'USRA ont considérablement augmenté en 1918.
- On peut alors observer qu'en réalité, Joe était diablement bien informé, et que, si les faits sont déformés, ils ne sont en rien inventés.
Ce passage peut alors apparaître clairement comme une attaque de Gonzales contre Thomas W. Wilson (et le parti démocrate plus généralement), dans laquelle Joe Fields n'est que l'outil permettant à l'auteur de critiquer le président avec un rapport efficacité / prise de risque imbattable.
w Tartarin de Lewisburg (1) | The Lion Killer (pages 45 à 52) |
Dans un récit précédent, une jeune femme travaillant dans la plantation de Lewisburg (l'une de celle que possédaient les Heyward), s'était amusée à fabriquer « le truc du Diable », un appareil produisant des bruits insolites qu'elle avait fait passer pour le rugissement d'un lion et grâce auxquels elle commençait à terroriser ses voisins. Comme on peut s'y attendre, Duncan Clinch Heyward y avait rapidement mis le holà, mais sans divulguer la supercherie. Voilà pourquoi les autres habitants de la plantation,
n'entendant plus la voix terrible se répercuter la nuit à travers bois ou le long des berges de la rivière, crurent que le lion, chassé par l'esprit des prières, était parti de chez eux pour aller dans quelque communauté moins pieuse. Ceux qui avaient raconté des contes fantatiques sur la créature féroce dont les yeux flamboyants avaient brûlé dans leurs âmes, dont les griffes ensanglantées les avaient glacés de terreur, racontèrent et racontèrent encore, avec enjolivements et force détails, (et finirent par croire eux-mêmes) les premiers récits de leurs rencontes avec le monstre. Quelques-uns de ceux qui n'avaient eu aucune exprérience personnelle du lion de Lewisburg crurent seulement à une partie des contes répétés à satieté. D'autres se montrèrent franchement sceptiques car, alors que pratiquement tous croyaient à l'existence du lion, peu étaient désireux de laisser aux conteurs le prestige d'avoir traversé sain et sauf d'aussi dangereuses aventures. […] D'une certaine façon, il était généralement admis que, venant à la rescousse des prières de la plantation, « Mass Clinch » (grâce à son magnétisme personnel ou par l'exercice de son autorité d'ancien gouverneur) avait beaucoup fait pour accélérer le départ de l'hôte à crinière. Cette rumeur voyagea à travers les vignes sur une cinquantaine de kilomètres, de la Combahee à Adams Run, séjour habituel de Joe Fields, l'ancien esclave (3) de l'ancien gouverneur, dont la confiance dans les pouvoirs de « Monsieur » n'avait de comparable que la croyance musulmane en la capacité de leur vénéré Prophète à approvisionner l'Au-Delà en Houris. C'était vrai que « Monsieur » avait ordonné aux rugissements de s'arrêter, et qu'ils l'avaient fait, mais l'imagination de Joe tenait à y ajouter tous les « détails le confirmant ». Joe retrouva quelques-uns de ses amis à la gare, car les choses n'allaient pas pour le mieux chez lui. Son épouse Philippa était un de ces êtres travaillant dur, mais exaspérant qui, par son énergie et son dévouement indéniables, imposait au seigneur oisif à qui elle était mariée le sentiment de sa propre infériorité. Philippa travaillait chez des Blancs, faisant la cuisine, le lavage et le ménage, tandis que Joe allait sur un cheval ou un bœuf hypothéqué, fanfaron comme un Sieur Oracle (3) aux Carrefours ou à la gare. Philippa voulait bien assurer à Joe sa nourriture quotidienne, mais elle n'était pas prête à se saigner aux quatre veines pour lui et, à chaque fois qu'elle revenait à la maison, son sens du devoir l'obligeait à rappeler à Joe ses défauts […] Joe, devant prendre la sauce avec la viande, perdait rarement à discuter un temps qu'il pouvait employer à manger, et se mettait le plus rapidement possible hors de portée de voix. Une fois parti retrouver ses camarades, il s'exprimait sans crainte ni retenue : — Cette femme n'arrête pas de parler, au point que je suis fatigué de l'écouter. Elle est comme le roncier quand la mûre est à point. Elle vous donne quelque chose à manger, mais elle vous écorche pendant que vous le mangez ! Pour sûr, c'est une femme de confiance, elle aime le travail, mais quand elle est rentrée à la maison, je n'ai plus un instant de répit. Apparemment, ce que je fais ne lui convient jamais. Si je m'assois dans ma chaise-à-bascule, pour finir de manger et me reposer, elle me crie dessus pour ça. Pareillement, si je monte sur mon bœuf pour aller au croisement, vous pouvez l'entendre parler d'un fainéant qui ne vaut rien ! — Est-ce qu'elle t'a jamais crié dessus quand tu prenais une hache ou bien une bêche ? — Qui ? moi ? Moi, tenir une bêche ? Non, m'sieur ! Le Noir d'un « Monsieur » ne prend pas une bêche en mains. Pourquoi devrais-je prendre en mains une bêche quand j'ai pour épouse la Noire d'un Blanc pauvre ? C'est à lui de tenir une bêche ! Le monsieur de Philippa est un Blanc pauvre de la ville. Il est boulanger depuis le temps de l'esclavage. Qu'est-ce qu'il a jamais fait ? Est-ce que lui, il a jamais tué un lion ? — Tuer un lion ! Tu parles des Noirs ? Qui as-tu jamais entendu parler de pouvoir tuer un lion ? — Mon monsieur en a tué un ! — Va jouer, Joe ! Tu rêves ! Et d'un, il n'y a jamais eu aucun lion dans ce pays, et de deux, tu n'as jamais eu de « monsieur », et de trois, si tu avais eu un « monsieur », il ne serait pas capable de tuer un lion. — Je n'ai pas eu de monsieur ! Vous ne le savez pas, que j'ai appartenu à Maître Clinch Heyward, des plantations de Lewisburg sur la Cumbahee ? Noirs ignorants, vous ne le savez pas, qu'il a trois mille acres de riz et plus de trois mille Noirs, mules, et tout le reste ? Vous n'avez jamais entendu parler de ce lion qui s'est échappé du cirque à Orangeburg l'autre jour et est descendu vers les marais de la Salkehatchie jusqu'à arriver à la Cumbahee et il a fait sortir tous les Noirs des champs et il a fait grimper à un arbre le surveillant de Monsieur, M. Jaycocks ? — Personne n'en a jamais entendu parler, Joe, et toi, tu n'en as jamais entendu parler. Qu'est-ce que tu as pu entendre ? Tu étais à la Cumbahee ? — Je n'étais pas à la Cumbahee, mais j'ai une amie qui vit dans la plantation de Monsieur, à la Cumbahee, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. — Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ton amie, Joe ? — Quand le lion s'est échappé du cirque, il a filé droit d'Orangeburg aux marais de la Salkehatchie, et il ne s'est pas arrêté avant d'arriver à Lewisburg ! — Et pourquoi s'est-il arrêté à Lewisburg, Joe ? — Vous ne le savez pas, que les Noirs y sont plantureux ? […] Monsieur a fait de si grande cultures de riz et de patates et de tout que ses Noirs sont beaucoup plus plantureux que tous les autres Noirs sur les bords de la Cumbahee ! Dès que le lion est arrivé à Lewisburg, il s'est arrêté. Il le savait, qu'il y aurait à manger, et il en a eu l'eau à la bouche. Un peu plus tard, durant la nuit, sa voix a traversé la plantation de pins de Monsieur et tous les Noirs ont été effrayés comme sont effrayés les poulets quand la buse étend sur eux l'ombre de son aile ! Alors, les Noirs sont devenus fous de terreur ! Ils se sont enfermés chez eux durant la nuit, et, bien que ce soit l'été, ils y ont fait du feu pour que le lion ne puisse pas descendre par la cheminée. Comme le lion n'avait aucun Noir à manger parce qu'ils étaient tous enfermés chez eux, il est allé dans les bois et a rencontré une vache et l'a tuée pour son repas. Quand il a eu mangé les trois vaches, … — Trois vaches ! Joe, comment a-t-il pu manger trois vaches alors qu'il n'en a tué qu'une ? — Il a mangé trois vaches, non ? Il peut les avoir mangées, peu importe si elles étaient mortes. Est-ce que vous avez jamais vu un lion ? Qu'est-ce qu'un Noir de Ponpon sait à propos des lions ? Apparemment, quand il a eu mangé les trois vaches, il est revenu dans le quartier des Noirs pour voir s'il avait une chance de manger un Noir. Il est allé et venu, il a fouetté l'air de sa queue, il a grincé des dents et il a crié comme un âne, un alligator et un taureau, tous les trois à la fois ! Vous pouviez entendre les Noirs faire leurs prières dans leurs maisons. […] Ensuite, quand il a fait jour et comme le lion n'avait attrapé aucun Noir, il est allé tuer quatre vaches de plus et quand il les a eu mangées, il est allé dans les bois et s'est allongé pour se reposer, et personne ne l'a plus entendu jusqu'au samedi soir. Pendant toute la semaine, les Noirs faisaient les fiers et avaient l'esprit tranquille parce qu'ils pensaient que leurs prières avaient fait partir le lion et les laisser en paix, mais lui n'avait fait aucune prière pour qu'ils partent, pour les quatre vaches qu'il avait mangées, remplissant son ventre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour un Noir. ! Quand le samedi soir est arrivé, le lion cria à nouveau, et tous les Noirs sortirent en courant du magasin et rentrèrent chez eux se cacher. Le lundi venu, les Noirs avaient peur d'aller travailler dans les champs de Monsieur. M. Jaycocks ne savait pas quoi faire. Il a envoyé un message à Columbia pour dire que s'il ne venait pas à Lewisburg, tous les Noirs finiraient dévorés. Monsieur a pris le train. Il est venu. Il a quitté la gare de White Hall, il est monté sur son cheval, il s'est tourné vers son surveillant : « Jaycocks, » a-t-il dit « où cette bête se cache-t-elle ? Laissez-moi la voir ! » M. Jaycocks lui dit que la dernière fois qu'ils avaient entendu sa voix, c'était dans les buissons, les roseaux, etc. du côté de la berge de la rivière. Monsieur n'a pas attendu d'en entendre plus. Il a pris le fusil des mains de M. Jaycocks, planté ses deux éperons dans le ventre de son cheval, le cheval a fait un bond de trois mètres en l'air et en route ! Monsieur a chevauché jusqu'à la jetée sur la berge de la rivière ; là, il a commencé à avancer lentement et à jeter des coups d'œil devant lui pour voir où cette chose était cachée. Quand il est arrivé près des ronces et du reste, son cheval a tendu l'oreille devant lui, a reniflé, et s'est dressé sur ses pattes arrière. Quand il a fait ça, Monsieur a su que le lion était dans les buissons ! Le cheval s'est remis sur ses quatre pattes. Il tremblait comme se secoue un ouvrier qui vanne le riz. Monsieur a entendu quelque chose grogner dans le roncier. Puis le lion est sorti. Quand il a ouvert la gueule, ses dents étaient longues comme un épi de maïs ! Monsieur a jeté un regard à son fusil. Il n'y avait qu'une balle dedans, et il a compris que s'il ne tuait pas cette chose fin morte, le lion les mangerait tous les deux, lui et le cheval. Monsieur a visé la gorge. Il n'a pas tergiversé, boum ! Quand le coup est parti, il a regardé ! La tête du lion a roulé sur la berge jusqu'à ce qu'elle tombe dans le fossé ! Monsieur est revenu à Lewisburg au grand galop. Il a dit à M. Jaycocks d'envoyer un chariot et quatre mules pour aller le chercher et le ramener à la plantation. Ils l'ont mesuré et il faisait plus de quatre mètres de long ! Quand les Noirs ont entendu qu'il était mort, ils ont arrêté le travail et fait un feu et crié autour du lion pendant toute la nuit que Dieu a faite ! Ensuite, des Blancs sont venus le voir, et quand ils ont endtendu qu'il faisait près de six mètres de long, ils sont restés sans voix. — Oui, je suppose que Noirs et Blancs restent sans voix pour peu qu'ils t'entendent leur raconter l'histoire, Joe. Ce lion a rallongé ! Avant, tu disais qu'il faisait quatre mètres de long. — La première fois qu'ils l'ont mesuré, il n'y avait pas la tête. Plus tard, ils l'ont mesuré après avoir remis la tête sur le cou, là où la balle de Monsieur l'avait coupée – n'est-ce pas ? Vous êtes sûrement des imbéciles ! — Joe, dit un autre camarade peu convaincu, comment une simple balle peut-elle couper la tête d'un lion ? Il a pris une épée ou bien une hache, pour faire ça ? — Celui qui a tué ce lion, c'est le Monsieur de qui ? Est-ce que c'est ton monsieur, peut-être ? Est-ce que je ne t'ai pas dit, Noir ignorant, que le cheval avait eu peur jusqu'à en trembler et qu'à ce moment-là, Monsieur avait pressé la détente ? Le cheval tremblait au point que la balle a cisaillé le cou du lion, au point de lui trancher la gorge d'une oreille à l'autre. |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Notes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
e Simon et Betsy | Simon, the « squerril » hunter (pages 82 à 86) |
Quand nous étions enfants, quelques années après la guerre (1), nous le connaissions comme un redoutable chasseur d'écureuils, et les Noirs du voisinage le connaissaient comme une redoutable vieille canaille roublarde ; son habileté lui avait valu le surnom d'Okra (2), à la fois hommage et reproche, car l'expérience qu'il avait acquise à décimer les vaches des Blancs et tout le reste dans les marécages, était parfois utilisée pour subtiliser un porcelet à quelque frère ou soœur de couleur des environs, quand Simon ne prenait pas la peine d'aller plus loin pour chasser et, aussi louables que fussent ses prouesses de se servir chez les Blancs (qui, en matière de spoliation, portaient sur leurs esclaves nouvellement libérés le même regard que les respectés Égyptiens sur les enfants d'Israël), les cénacles foncés considéraient comme immoral de voler ceux de sa propre couleur. Bien que toujours soupçonné, le vieil Okra n'était jamais pris. Quand il tuait une vache ou quelque autre gros gibier, la peau et la tête, avec ses marques révélatrices aux oreilles, étaient brûlées soigneusement au fond des bois, et une partie de la viande distribuée aux camarades, assurant à Simon non seulement un silence protecteur mais aussi un bon contingent d'alibis circonstanciés, pour le cas où les soupçons se transformeraient en accusations. Les Noirs doivent être du côté des Noirs étant le mot d'ordre de toutes les plantations alentour. Le chasseur d'écureuils était aussi maigre et émacié que Cassius (3), avec un regard fuyant et un visage ravagé par la petite vérole. Il avait une démarche furtive et silencieuse, et pouvait aller à travers bois du lever au coucher du soleil sans être fatigué.[…] La plupart des sportifs noirs nouveaux venus se contentaient de chasser les écureuils-chats qui remplissaient les bosquets de chênes et de caryers des marécages, mais Simon avait de l'ambition et chassait habituellement les beaux écureuils-renards, gris et noirs, créatures méfiantes que l'on croisait rarement et qui se trouvaient seulement dans les hauts pins […] Même un enfant savait alors que c'était gaspiller de la poudre précieuse et son tir que d'essayer de lui faire quitter son sanctuaire, mais pas le vieil Okra. Il avait une foi secrète et un orgueil sans borne dans les pouvoirs de son vieux muskick (5) – La vieille Betsy, elle ne peut pas tirer pour des prunes – et il défouraillait autant que duraient ses munitions, visant un point gris ou noir tout en haut d'un géant de la forêt ; visant d'ailleurs souvent un écureuil mort, car ces « renards » ont l'habitude extrêmement regrettable d'enfoncer leurs griffres si profondément dans l'écorce qu'ils restent suspendus une fois morts et sont très difficiles à faire tomber. […] La curiosité d'apprendre comment il réussissait pouvait parfois s'avérer imprudente, car Simon mendiait toujours de la poudre, et son insinuant « Monsieur — à vot' bon cœur » manquait rarement de lui valoir une part de la bouteille de poudre du pauvre magasin, mais malheur au pauvre magasin s'il était permis à Simon de la verser. Un jour craquant d'hiver, Simon et son fils, un adolescent appelé Boyzie, se retrouvèrent sur un haut plateau planté de pins, ponctué d'une série d'étangs pouilleux et peu profonds. Soudain, du bord d'un étang, à une petite centaine de mètres, on vit la queue comme emplumée d'un gros écureuil-renard gris, ondulant par saccades au-dessus du sol pendant qu'il courait vers les arbres. Nos hommes le prirent en chasse et parvinrent à le coincer dans un bosquet de jeunes pins des marais avant qu'il n'atteigne les grands arbres. Les yeux de Simon luisaient comme des galets bruns au travers des eaux lumineuses d'un ruisseau peu profond. Son indolence s'était envolée et il n'était plus que vigilance et anxiété. — Où est-il, Boyzie ? Où est-il ? — Le voilà, papa ! Le voilà ! Regarde ! Regarde ! Fais boum ! tonna Betsy, et le recul fit chanceler Simon, tandis que le tir coupait net le sommet d'un pin des marais, dont l'écureuil descendit en courant et détala pour se réfugier dans un grand pin peu éloigné, parcourant le tronc en longues spirales. Regarde-le, Boyzie. Ne le perds pas des yeux jusqu'à ce que j'aie rechargé Betsy et Simon, en tout hâte, mit en place une nouvelle charge, avec de fréquents regards furtifs vers sa sentinelle pour vérifier que le garçon ne tournait pas les yeux dans le vide. Sortant d'un chiffon graisseux une énorme capsule de cuivre […], il adapta l'embout et arma le fusil, une opération aussi laborieuse que d'appuyer sur la détente, car à mi-charge, le chien de Betsy penchait en arrière comme comme la tête d'un dindon qui se pavane, tandis qu'à pleine charge, la coupelle s'ouvrait vers le ciel comme un Mauna Loa (6) en miniature. Faisant le tour du pin, il essaya de localiser l'écureuil qui maintenant était allongé sur une fourche près de la couronne du pin des marais, sa longue queue pendant le long du tronc tandis que se corps était bien caché. Boyzie désigna la queue qui pendait. Le chien était relevé, deux doigts nerveux pressèrent la détente avec une secousse qui aurait surpris n'importe quelle cible, et le chien, décrivant une parabole, tomba sur la capsule qui explosa avec une détonation semblable à une arme de salon, mais le museau de Betsy demeura renfrogné et silencieux. — Qu'est-ce qu'il y a, Betsy ? Tu as un nom de femme, et tu n'as pas une bouche de femme ? Tu ne peux pas parler ? C'est le diable ! Puis ce furent une autre capsule, une autre visée pleine d'espoir, et un autre petit « pof ! » qui se répercuta sur les pins. […] — Une sorcière doit avoir jeté un mauvais sort à Betsy. J'attendrai qu'il soit conjuré. — Papa, est-ce que tu as mis de la poudre dans le fusil ? — Qui ? Moi ? Quel fusil ? Betsy ? Bien sûr que j'ai mis de la poudre dedans. — Ce serait mieux d'essayer… dit le jeune garçon dubitatif, et il joignit les actes à la parole. Quand le coup fut tiré et que la vis de la longue tige métallique vint frapper la culasse du fusil, le visage du vieil Okra était un sujet d'étude. — Oui, si je n'avais pas dû surveiller Boyzie surveillant l'écureuil, je n'aurais pas oublié de le charger. Se satisfaisant de cette décharge de responsabilité, il rechargea soigneusement le fusil et fit feu, emportant, avec un lot d'aiguilles de pin, la moitié de la queue de l'écureuil, qu'il lia dans la corde qui attachait son vieux chapeau ; et il fit cette remarque : |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Notes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
r Un talisman vagabond | The « cunjuh » that came back (pages 87 à 95) |
Lucy Jones, de Ponpon, honnête et vaillante veuve, avait durant sa jeunesse éé mariée aussi souvent que la Femme de Bath (1). Cependant, la mort, l'incompatibilité d'humeur ou l'indifférence avaient mis fin à ces unions l'une après l'autre […] Et Lucy se languissait. Elle ne prenait plus de plaisir à « la bouillie de maïs » ou « la farine sure ». Elle n'avait plus de goût pour le porc aux légumes ou le gigot de mouton. Le lard, s'il lui graissait la bouche, ne lui pommadait plus l'âme. Sa chambre était douillette et confortable, son lit était large et garni d'une couverture brodée qui aurait fait passer les vêtements de Joseph (2) pour une triste vareuse de toile kaki (3). Cette couverture, fabriquée patiemment à partir de tous les morceaux de tissu brillants (soie, coton, laine) qu'elle avait mendiés auprès des Blancs pendant plusieurs années puis qu'elle avait cousus ensemble d'une main minutieuse et d'une âme exaltée, elle avait la certitude que son achèvement conduirait un mari à partager l'éclats de ses couleurs. — Tout le temps que je passe à faire cette couverture, j'ai l'esprit qui trépigne à me demander quel genre de mari j'aurai quand j'aurai fini. Parfois, je pense que ce sera un jeune Noir, et alors je me rappelle que ces jeunes ne valent rien. Ils aiment trop jouer aux dés. Alors, à un autre moment, je réfléchis et je pense que j'obtiendrai un homme bien établi, mais je sais très bien que j'aurai à prendre un homme, comme ci ou comme ça, parce que je suis trop seule. Et je continue à coudre ma couverture, et je la mets sur le lit. Cette nuit, quand je suis allée dormir, j'ai fait un rêve, et un esprit est venu en moi durant le rêve et m'a dit qu'épouserais Isaac Middleton. C'est ainsi que l'idée se fit jour. Isaac était grand, autant que Lucy était courtaude ; Isaac était mince autant que Lucy était forte, et Isaac était prudent autant que Lucy était entreprenante. Lui-même veuf depuis longtemps, il vivait seul quand Lucy lui fit savoir qu'elle désirait troquer son nom gallois de Jones pour le patronyme anglais et aristocratique de Middleton . Middleton se dit sensible au compliment mais déclina poliment l'offre, préférant garder sa maison solitaire pour lui. — Je lui ai dit ce qu'avait déclaré l'esprit, déclara-t-elle, et je lui ai dit que l'esprit avait déclaré qu'il m'épouserait cette même nuit. J'avais confiance dans la parole de l'esprit, j'ai nettoyé la maison, fait le lit, mis le thé sur le feu, et pourtant Middleton n'est pas venu. Je n'ai jamais connu de Noir aussi stupide que celui-ci. Quand j'ai été sûre qu'il ne viendrait pas, je suis allée le trouver à la gare, et je lui ai répété ce que l'esprit avait déclaré. Je lui ai parlé de la couverture, et du thé, et de tout le reste, et je lui ai dit de ne pas se faire de souci à propos de sa maison, parce que j'en avais une où nous vivrions tous les deux, mais Middleton n'a pas été d'accord avec ce que je lui avais dit à propos de l'esprit. Il a dit que, s'il voulait lui envoyer une femme, l'esprit devrait parler d'une jeune femme. Je lui ai dit qu'une jeune femme ne pouvait pas faire l'affaire comme épouse d'un homme rassis comme Middleton, parce qu'elles aiment trop les vêtements mais, apparemment, je n'ai pas pu lui remettre l'esprit droit. Aussi […] rentra-t-elle chez elle, déçue mais pas désespérée, bien décidée à ne pas dévier de sa route, […] car elle désirait Middleton d'un désir intense. — Lucy Middleton, Madame Middleton, comme ça vous remplissait la bouche et les oreilles, et gonflait l'esprit de satisfaction. […] Ainsi, alors que Lucy méditait et filait la toile d'araignée dans laquelle elle espérait prendre le prudent et ingrat Isaac, son esprit traversait les mers tempêtueuses de l'Entreprise et, bien à l'abri dans le hâvre douillet de la Réussite, elle pensait au travail accompli et s'imaginait allant au travail durant la semaine, à l'église le dimanche, et aux réunions le soir, en portant, comme faisant partie d'elle-même, le tant désiré « titre » d'Isaac. Et elle pensait aux occasions où, sur la grand route ou dans une allée, elle « passerait le temps du jour » dans le cérémonial de salutations si chères à sa nature. Elle débordait d'extase, et la mélodie de « Middleton » faisait vibrer ses tympans. — Bonjour, madame Jones, comment allez-vous, madame ? — Bonjour, monsieur Wineglass, bien, Dieu merci, mais vous savez que je ne suis plus maintenant madame Jones, je suis madame Middleton. — Vraiment ? Je n'ai jamais entendu parler de la mort de frère Jones. — Non, madame, il n'est pas mort, madame, mais il a une autre épouse, et moi, j'ai Isaac Middleton. Vous savez, le même monsieur Middleton qui vivait près de la gare d'Adams Run ? Eh bien, c'est maintenant mon mari, et je suis madame Middleton. — Oui, madame, bien, bonjour, madame, et ainsi de suite. Et tandis qu'elle était assise au soleil devant la porte de sa maisonnette et fumait sa courte pipe d'argile, ou bien dans la solitude de la nuit […] sous la couverture qui ressemblait à une carte des comtés du Texas, sans cesse, Lucy envoyait sa pensée vagabonder du côté de la gare d'Adams Run, près de laquelle habitait le récalcitrant Middleton. Jour et nuit, de nombreux trains empruntaient cette artère ferroviaire de la Ligne de la Côte Atlantique ; le grincement criard d'un train de marchandise local s'arrêtant sur une voie de garage de la station éloignée lui rappelait que les oreilles de Middleton étaient remplies du même bruit. […] Chaque coup de sifflet poussé le long de la ligne fréquentée rappelait à Lucy le chemin de fer, et le chemin de fer lui rappelait la gare, et la gare lui rappelait Middleton. En théorie, […] le dogme selon lequel « une femme n'a qu'à penser au mariage pour que ce soit fait » est probablement aussi vieux que la Création (puisqu'Adam, en galant homme qu'il était, accepta avec philosophie, sans rechigner – et même avec courtoisie – l'épouse que le Ciel lui avait destinée). Mais un surcroît de réflexion avait conduit Lucy à la conclusion que, dans sa chasse au mari, elle était après tout un teckel tandis que le fuyant Middleton était un renard. Comme la défense de l'homme s'était révélée impénétrable lors d'une attaque directe, elle avait essayé un travail de sape et de contournement, mais sans succès : même l'obus « esprit » lancé sur Middleton n'avait pas eu plus d'effet qu'un pétard mouillé ; sa maison et le jardin qui l'entourait étaient encore – hélas ! – sans homme ! Dans son désespoir, Lucy décida de recourir à la magie ! Comme le vieux Lorenzo dans « La Mascotte » (5), elle croyait aux « signes, présages rêves, prédictions », et aussi au pouvoir de la grenouille séchée, de la peau de serpent noir, et aussi du chiffon de flanelle rouge imbibé de pétrole lampant – comme autant de talismans pour mener un amoureux à destination, pour jeter un sort entraînant la maladie ou la mort sur un ennemi, ou pour tout autre but […] Elle se souvint alors du vieux Simon, pas un véritable sorcier, parce qu'il n'avait pas de tarif fixe, mais un vieux pécheur rusé, une sorte d'amateur de la magie noire, qui donnait des conseils gratuitement, quoique ses services fussent toujours récompensés par des œufs, des patates douces ou du riz décortiqué. Comme les peaux de serpent et les grenouilles séchées faisaient partie de presque tous les « talismans » du vieux Simon, les enfants du quartier lui apportaient souvent ce qu'ils tuaient ou trouvaient mort sur le bord de la route. Il les écorchait et salait à son gré, ou les enrobait dans la cendre, les fumait, les séchait et les mettait dehors, pour les utiliser quand l'occasion le demanderait.[…] Et c'est ainsi que Lucy, dans l'obscurité de la nuit naissante et en l'absence de la lune (car elle souhaitait tenir ses sœurs noires à l'écart de ses afffaires), ferma sa maison, se mit un foulard sur la tête et se glissa jusque chez Simon. Il faisait froid et la porte de Simon était fermée. Elle frappa doucement, furtivement, et un aboiement féroce répondit de l'intérieur. Simon vint en boitant jusqu'à la porte et l'ouvrit, un roquet noir grondant à ses pieds. Éloignant le chien, il fit entrer Lucy. — Entre, ma sœur, comment vas-tu ? — Bien, Dieu merci, Oncle Simon. Je viens te demander de me donner un sort à jeter sur Isaac Middleton, qui habite près de la gare d'Adams Run, pour le faire obéir aux paroles de l'esprit qui lui a dit de m'épouser, parce que je lui ai dit deux fois ce que l'esprit avait déclaré mais il ne tient pas compte des esprits et se soucie de moi comme de sa première chemise, et il dit qu'il doit épouser une jeune femme parce qu'il n'a aucune envie d'épouser une femme bien établie, et je lui ai dit qu'une jeune femme ne convenait pas à un homme rassis, mais Middleton ne veut rien savoir et s'obstine, je ne peux rien obtenir de lui, et s'il te plaît, fais-moi un talisman puissant, car Middleton est aussi entêté qu'un bœuf et un mulet réunis ; dis-moi ce que je dois faire pour lui et où je dois le mettre pour jeter le sort sur Middleton, et j'irai te chercher trois œufs et de l'igname jaune et des patates douces pour que tu aies à manger. Et elle sortit ces cadeaux de sous son tablier et les présenta au jeteur de sorts. Simon n'était pas bavard. Allant vers une vieille cuvette où il gardait son stock de matières premières, il y farfouila et finit par en tirer la peau desséchée d'un mocassin « à ventre cuivré » (5) d'environ un mètre de long. Il l'enroula outour d'un crapaud fumé, auquel il ajouta deux clous rouillés de fer à cheval. Il entoura le tout d'une bande épaisse de flanelle rouge, bien marinée dans le pétrole lampant, et le talisman fut prêt. L'enveloppant dans une feuille de papier brun, il le donna à Lucy qui, tremblant de bonheur et d'excitation, l'attacha dans un coin de son tablier. — Ma fille, tu n'as pas peur de prendre la route au milieu de la nuit ? — Non, monsieur, je n'ai jamais peur quand il s'agit d'aller à la maison de Middleton. — Très bien alors, tu vas à la maison de Middleton cette nuit. Tu prends ce talisman et le mets sur le seuil de la maison de Middleton, et tu marches discrètement pour qu'il ne t'entende pas. Tu as compris ? — Oui, monsieur. Grand merci, au nom de Dieu. Et elle repartit chez elle en hâte. Pendant quelque temps, elle somnola devant son feu et puis, une heure avant minuit, avec cet instinct incroyable qui guide ceux qui vivent près de la nature, elle se leva, et avec son précieux talisman, ele partit à toute vitesse à la gare. Alors qu'elle se hâtait dans l'obscurité, un raton laveur traversa sans bruit son chemin. Plus loin, un renard gris troitta sans crainte devant elle pendant quelques mètres puis se jeta dans les fourrés et disparut. Le cri terrifiant d'une chouette rayée au rire sauvage la survola alors qu'elle suivait une allée dans la forêt, lui glaçant le cœur durant un instant, mais la pensée de Middleton lui réchaffa les ventricules et elle poursuivit sa route. Finalement, elle atteignit la demeure de Middleton et, remerciant sa bonne étoile qu'il n'ait pas eu de chien, elle souleva avec précautions le loquet de la porte de son jardin et s'avança sur la pointe des pieds jusqu'aux marches où, avec une prière silencieuse pour le succès de son entreprise, elle déposa le précieux « talisman » et se retira sans bruit. Juste à la fin du « quart » des marins, juste avant le « petit jour » des Noirs – l'heure que tous les travailleurs de nuit reconnaissent quand, avec l'imminence de l'aube, quelque chose du poids du monde paraît s'envoler de leurs épaules – Middleton se leva de son matelas de cosses de maïs et, ouvrant la porte de sa maison, regarda devant lui, comme c'est l'habitude des Noirs tôt levés, pour observer le ciel et évaluer les promesses du jour à venir. Une lune bosselée d'or sombre, nouvellement levée, s'accrochait à l'horizon, à l'est. Diane était à la diète depuis dix jours (6), et bien que sa taille eût décru, elle donnait encore assez de lumière pour ouvrir les yeux et exciter la gorge de tous les coqs des environs, et depuis les champs des maison solitaires dans les bois et les quartiers de la plantation, leur voix, perçante et claire ou profonde et rauque, parvenait aux oreilles de Middleton quand ils saluaient l'or des fous (8) du clair de lune en croyant annoncer l'aurore. — Les volailles doivent croire que le jour se lève commenta Middleton, et, comme il ouvrait la porte en grand pour mieux voir, son pied nu entra en contact avec la peau de serpent glacée, et la peur le jeta en arrière. Craquant une allumette, il enflamma un morceau de bois léger et découvrit le « talisman » placé mystérieusement en plein milieu de son seuil. Il se gratta la tête avec perplexité : — Eh ! qu'est-ce que c'est ? Je n'ai jamais fait de mal à personne. Je me demande qui peut bien vouloir me jeter un sort ! Dieu merci, je n'ai pas marché dessus. Persuadé que, s'il n'avait pas marché dessus, aucun mal n'en pouvait venir, il le ramassa courageusement et alla le placer dans une fissure de la cheminée d'argile, jusqu'à ce qu'il ait trouvé l'occasion d'utiliser l'instrument redoutable que la Providence avait placé entre ses mains. Toute la journée, il balança car, n'ayant pas d'ennemi, il n'y avait personne à qui il voulût du mal. À la fin, quand le soir tomba, de sombres pensées vinrent avec le crépuscule, et un sinistre dessein se glissa dans son esprit, qu'il mit à exécution séance tenante. Vénus est l'étoile de la nuit, mais elle ne lui parla pas, car il n'y avait pas d'amour dans son cœur et son esprit ne concevait que le projet de mettre fin une fois pour toutes aux tentatives importunes de la traqueuse de maris. — Je vais prendre cette chose et la porter à la maison de cette femme, pour lui jeter un sort afin qu'elle se rabatte sur un autre homme et me laisse tranquille. Marchant d'un pas vif vers la maison de Lucy, où celle-ci dormait sans rien soupçonner sous sa couverture disgracieuse, il plaça soigneusement le talisman au milieu de la marche supérieure et rentra chez lui, sous un beau ciel étoilé. |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Notes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- fools' gold est le nom couramment donné à la pyrite, notamment au temps de la ruée vers l'or, parce que certains chercheurs se laissaient prendre à la ressemblance ;
- ailleurs, l'expression fait écho à un vers de Shakespeare dans Le Marchand de Venise selon lequel Tout ce qui brille n'est pas de l'or ; donc seuls les fous peuvent confondre la lumière avec la matière ;
- mais les coqs sont doublement fous puisque non seulement ils confondent la lumière avec la matière, mais en plus, ils confondent la lumière de la lune avec celle du soleil ;
- reste un dernier calembour possible entre l'anglais fool et le gullah fowl qui désigne les animaux de basse-cour, donc les coqs, même quand ils ne sont pas spécialement stupides.
t À ravissante embobineuse, embobiné ravi | 'The wiles that in the women are' (1) (pages 128 à 133) |
Pendant de nombreuses années, le vieux John, en tant que cocher de campagne du défunt gouverneur Aiken (2), conduisait régulièrement une couple de mulets à la queue empanachée, attelés à la voiture du Gouverneur, faisant des voyages en boucle entre l'île de Jehossee (3) et la gare d'Adams Run, à chaque fois que son employeur venait de Charleston visiter sa grande plantation de riz. John était un vieux Nègre soigné et méticuleux, avec un certain style, et son vieux chapeau de castor ainsi que sa veste à longs pans lui composaient un personnage remarquable au milieu des Nègres qui traînaient habituellement dans la gare. Les Noirs du Bas Pays ne manquent jamais leur train. Quand ils doivent voyager en chemin de fer, ils ne prennent aucun risque et arrivent toujours à la gare plusieurs heures avant celle qu'indique l'horaire ; et le temps passe vite, agréablement rempli de conversations et de bavardages. Au milieu de ces groupes, avec son fouet à long manche et à mèche de daim tressé proprement enroulé et tenu à la façon des cochers, le vieux John déambulait et échangeait des plaisanteries. Lui aussi était toujours nettement en avance et ses mulets dociles, balançant leurs longues queues bien garnies et attelés à la seule berline de la région, étaient toujours le centre d'intérêt des oisifs de la gare. — Oncle John, pourquoi vous ne rasez pas les queues des mulets ? demanda quelqu'un dans le groupe qui stationnait près du quai. — Ma sœur, tu n'as jamais entendu parler des moustiques de Jehosse ? — Non, monsieur. — Ah ! je m'en doute. Ma fille, as-tu jamais vu des merles au-dessus d'une balle de riz ? Tu en as vu, n'est-ce pas ? Très bien. Les moustiques, dans les marécages de Jehossee, se comportent de la même façon. Quand ils volent au-dessus des mulets, ils les recouvrent au point que tu ne peux même plus voir les harnais ! Une fois, juste après le crépuscule, je revenais tardivement d'Adams Run, et quand j'ai atteint la route, tout d'un coup, je n'ai plus entendu les sabots des mulets trotter sur le sol ! La voiture avançait, mais je n'entendais aucun son venant des sabots des mulets. Je me dis en moi-même « Eh ! qu'est-ce que c'est que ça ? » Je regarde à nouveau, et, je le jure, il y avait une telle épaisseur de moustiques sur le ventre des mulets qu'ils les avaient soulevés du sol et les transportaient dans l'air ! Leurs ailes vrombissaient comme un essaim d'abeilles, et les mulets trottaient avec tous les moustiques devant leurs pieds mais ils ne touchaient jamais le sol ! Je n'ai rien fait jusqu'au pont, parce que le pont est fait de rondins qui sont très glissants la nuit, et j'étais très content que les mulets n'aient pas à mettre les pieds dessus, mais après avoir traversé le pont, j'ai pris mon fouet et j'ai claqué deux ou trois fois au-dessous du ventre des mulets, et, sur la tête de mon Maître, trois paquets de moustiques sont tombés sur le sol, et j'ai à nouveau entendu le bruit des sabots des mulets trotter sur la route ! Alors, après ça, je n'ai plus jamais rasé la queue des mulets de la voiture du Gouverneur, et maintenant, vous les voyez là, ils peuvent frapper les moustiques, les mouches et tout le reste, aussi bien que si c'étaient des chevaux. Et c'est ainsi que le vieux John, cocher et raconteur (5), serviteur fidèle et respecté, passa ses jours, qui furent nombreux, et quand, à la fin, il rejoignit ses ancêtres, ses obsèques furent le sujet de conversation des gens de couleur de la région ; et sa tombe, joliment décorée de morceaux d'antique porcelaine de Chine bleue et de ces bouteilles en pierre dans laquelle la bière Bass était importée à une certaine époque, fit l'admiration de ceux que de tristes devoirs menaient au Champ de Dieu à l'ombre des grands chênes. — Ah ça ! Pour sûr, frère John a une bien belle tombe. — Oui, sœur, ele est vraiment belle. Tu vois ce bleu de Chine, n'est-ce pas ? Ce bleu de Chine a été un pichet de sa Maîtresse jusqu'à ce que le col du pichet se brise. Un jour, sa maîtresse a envoyé une petite servante noire à une grande source avec le pichet bleu pour rapporter de l'eau. La jeune fille a rempli le pichet et l'a mis sur sa tête pour faire le chemin du retour jusqu'à la maison. Elle marchait sans faire vraiment attention, balançait les mains, regardait en l'air au lieu de regarder le chemin ; or une petite tortue traversa sa route au même moment où passait la servante, et celle-ci mit le pied sur la tortue, et la tortue la précipita par terre, et le pichet tomba de la tête de la jeune fille et cogna sur une racine, et le col du pichet se brisa ; la jeune fille retourna à la grande source et remplit à nouveau le pichet, et le mit sur sa tête et refit le chemin vers la maison de ses maîtres, mais elle craignait que la tortue ne vienne à nouveau la heurter, elle levait haut les pieds, et quand elle levait haut les pieds, l'eau qu'elle avait prise à la grande source giclait du col cassé du pichet, et tombait dans les yeux de la fille, et coulait sur son visage et allait dans sa bouche et quand la jeune fille arriva à la maison, sa maîtresse regarda toute l'eau et tout le reste sur son visage, et elle pensa que la fille pleurait à cause de ça, et sa maîtresse en fut attristée et ne la battit pas ni rien, et donna le pichet au col cassé à la servante, et quand la jeune fille eut grandi, frère John la prit pour épouse et, de ce fait, frère John eut droit au pichet et, une fois frère John fin mort, sa veuve a laissé prendre une hachette et casser complètement le pichet, et mettre chaque morceau que Dieu avait fait sur la tombe de frère John, et voilà pourquoi les choses sont comme elles sont. — Sa tombe a belle apparence, à coup sûr, mais je sais bien que, quand mon mari mourra, je ne casserai ni pichet ni quoi que ce soit pour le mettre au-dessus de son cercueil, parce que ce ne sera pas nécessaire : il aime trop boire du rhum, et quand il en rapporte à la maison, il tombe par terre et casse la bouteille dans laquelle il l'a rapporté, et j'ai tout un tas de bouteilles brisées dans un coin du débarras, pour les mettre sur sa tombe quand il mourra. Deux ou trois fois, Joe a semblé s'interroger sur ces bouteilles cassées, et m'a demandé pourquoi je les gardais mais je lui ai dit que je les gardais pour les écraser au pilon, pour empoisonner les chiens des Blancs, et ça le satisfait, et il me laisse en paix. — Pour sûr, tu es avisée, sœur, parce que l'homme ne doit jamais en savoir trop. Si la femme lui dit toute la vérité, il n'est jamais satisfait. La femme doit lui mentir pour qu'il puisse avoir l'esprit tranquille ! — Tu dis vrai, sœur, il aime qu'on lui mente. Lui mentir est la seule façon qu'il te croie. — Oui, l'homme, j'ai moi-même une bonne expérience pour lui mentir. Une fois, Paul (c'est mon mari) devait travailler à la mine (5), pour creuser le rocher, en bas, dans Johns Island. Le lundi matin, il s'est levé de bonne heure, il est allé à la gare, il a pris le train et il est parti ! Je ne l'ai pas revu avant le samedi soir. Qu'est-ce que je devais faire ? Rester assise dans ma maison jusqu'à ce qu'il revienne, à regarder les pommes-de-terre bouillir ? Non, monsieur ! J'aime trop la conversation ! Dès que j'ai entendu le train siffler, et eu le plaisir de voir mon mari parti, mes pieds m'ont conduite au carrefour de Parker's Ferry (6), là où les Blancs ont leur grand magasin. Tous les garçons qui n'ont rien à faire vont y bavarder et il y a assez de femmes pour faire la conversation sur les hommes et le reste. Quand la nuit est tombée, je suis rentrée chez moi. J'ai fait la cuisine, j'ai mangé, je me suis couchée, j'ai dormi. Le mardi matin, je suis partie de la même manière, et chaque jour que Dieu a fait, jusqu'au samedi de son retour. J'ai nettoyé la maison, fait la lessive, balayé la cour et je suis allée au carrefour. J'y ai passé la journée avec un autre Noir, jusqu'à ce que j'entende siffler à la gare le train venant de Charleston ; alors, j'ai décidé de rentrer chez moi attendre le retour de Paul. Mais avant que je ne quitte le magasin, Sancho Frazier a bu du rhum et a payé très largement, et il a acheté environ deux quarts de bonbons, ceux d'un genre collant, ils ont un nom de femme, les Blancs les appellent Clara Mel (7), mais quoi qu'il en soit, c'est fait avec de la sève de pin et de la mélasse, et si tu mâches ça, tu en as plein les joues jusqu'à ce que le tonnerre gronde. Les Blancs l'avaient dans leur magasin depuis l'année dernière, et c'était aussi dur que du fer. Sancho en a donné deux poignées à chaque dame. J'en ai mis une dans un papier que j'ai fait disparaître dans la poche de mon tablier. J'ai mis l'autre dans ma bouche et j'ai commencé à mâcher. J'ai mâché et j'ai mâché, j'ai mâché et j'ai mâché. La chose m'a paru sucrée, c'est vrai, mais elle m'a pris les joues et je la tenais comme un pansement en sève de pin ! Plus je mâchais, plus elle gonflait. Le temps de revenir à la maison, ça m'a enveloppé chaque dent comme le celastrus enveloppe l'arbre. Mes deux joues étaient comme celles des dindons et ma bouche a gonflé comme celle de Frère Quash (8) quand il se met en colère ! Quand je suis arrivée près de la porte, Paul m'attendait ! Avant qu'il ait pu me poser une question, j'ai eu la bonne idée de placer mon tablier devant ma bouche pour la cacher, […] et j'ai commencé à gémir. J'ai gémi, et encore gémi. Paul m'a demandé pourquoi je gémissais comme ça. J'avais du mal à parler, mais je lui ai dit que j'étais allée du côté de la clôture et que j'avais marché sur un nid de guêpes jaunes, et que la chose m'avait piquée (9) comme ça. Il m'a demandé quelle joue la chose avait piquée. J'ai montré ma joue gauche. Il m'a demandé pourquoi les deux joues étaient gonflées. Je lui ai dit que c'était un abcès à la gencive (10) qui avait fait gonfler l'autre joue. Alors, j'ai commencé à pleurer. L'eau a inondé mes yeux. Je lui ai demandé d'aller à la gare et de demander aux Blancs une pommade pour mes deux pauvres joues. Paul a dit qu'il pouvait aller en acheter au carrefour, mais je craignais que s'il allait au carrefour, Sancho en vienne à lui dire que j'y étais allée ; alors, je lui ai dit non, je ne voulais pas qu'il dépense son argent parce que je l'aimais trop, et que je préférais qu'il aille demander aux Blancs, et qu'il l'achète sans avoir à dépenser son argent à lui (11). L'idée l'a satisfait et il est allé à la gare. Dès qu'il est parti, j'ai essayé d'enlever de ma bouche cette satanée traîtresse de Clara Mel. La chose me collait aux dents autant que Frère Lapin colle à Taar Baby (12). Elle ne voulait pas me lâcher ! Alors mon génie (13) m'a dit d'y mettre de la graisse. J'ai été à la maison, j'ai fait du feu, j'ai mis une tranche de lard dans la poêle, et quand la viande a été frite, je l'ai mise dans ma bouche et j'ai commencé à mâcher. Peu après, la graisse a commencé à faire partir Clara Mel, et j'y ai mis les deux mains, et je l'ai enlevée de ma bouche, et je l'ai jetée loin, le plus loin possible ! Quand Paul est revenu avec la pommade des Blancs, j'ai tenu mes deux joues et j'ai gémi. Il m'a donné le produit, je l'ai étalé, et peu après, quand il a eu fait cuire la nourriture qu'il avait rapportée de Johns Island, je l'ai appelé pour qu'il regarde mes deux joues, d'où le gonflement était parti, et ça l'a satisfait, il m'a donné l'argent qu'il avait préparé pour acheter la pommade au carrefour, et il n'a jamais entendu parler de Sancho ! — Oui, sœur, la femme l'embobine, à coup sûr ! Elle est faite pour l'embobiner. |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Notes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
y Un mariage de [dé]raison | A marriage of convenience (pages 174 à 182) |
Il y a vingt-cinq ans, la vieille Jane était la cuisinière très compétente de l'hôtel de Pawley's Island (1). Une veuve dans la cinquantaine ; son visage noir, avec un nez aquilin et un menton carré, était malin et lui donnait un air de sorcière. On rencontre peu de « vieilles filles » parmi les Noirs du Bas Pays, car la plupart des femmes arrivent au mariage (ou ont des projets de mariage) dès le jeune âge, dans des sociétés où mariages et sépations sont parmi les incidents les plus ordinaires de leur vie sociale et économique – et ressortissent pour l'essentiel des relations socio-économiques. « Il me faut une épouse pour me faire la cuisine et me laver mes vêtements, n'est-ce pas ? » « Il me faut un homme pour travailler pour moi et s'occuper de moi, non ? » – et hop ! ils étaient mariés. Souvent cependant dans leur jeune âge, plus rarement vers le milieu de leur existence, les femmes restent quelque temps sans mari, ou, pour parler plus exactement, sans attache, et si l'une de ces « absences d'attache » vient à durer plus longtemps qu'une simple interruption dans le cursus matrimonial, cette personne, si elle est du beau sexe, subit la réprobation générale censément liée à l'état de « vieille fille ». Jane avait, en son temps, envisagé le mariage en jaune, en brun ou en noir, et avait presque parcouru l'échelle des couleurs s'agissant du caractère aussi bien que de la pigmentation. Les plus raides l'avaient agacée, les plus gras l'avaient fatiguée, les « normaux », ni trop raides ni trop gras, étaient, comme les affaires du Petit Ours (2), « juste comme il faut », et Jane, comme la Bourgeoise de Bath de Chaucer (3) remerciait le Seigneur tant qu'ils restaient. « Mais les plaisirs sont comme le flot des coquelicots » (5) et, comme dans la société des gens de couleur de Georgetown les maris ne restent pas toujours « en place », un par un, les coquelicots de Jane (peut-être les voyait-elles comme des gueules de loup) replièrent leurs pétales et leurs tentes, et, abandonnant le sombre compagnonnage d'un amour vieilli, s'envolèrent vers la liberté pour l'immédiat et un éventuel asservissement pour la suite, car il y a toujours une suite — si le raton laveur n'a qu'un arbre où grimper, le chien l'attrapera. Comme Jane ne pouvait pas avancer sous un double harnais, elle réussit à aller à cloche-pied pendant plusieurs années – avec tant de succès qu'elle développa un fier dédain du sexe opposé. Ils ne valent rien, pensait-elle, et ils ne valent rien disait-elle à chaque fois qu'on parlait des hommes. Dans sa solitude, elle trouva du réconfort dans ses activités et, exerçant divers métiers durant l'hiver, elle compléta ses revenus l'été à l'hôtel, et eut bientôt assez pour acheter « un morceau de sol » (les Noirs de la Côte ne parlent jamais de terre) et faire construire dessus une agréable maisonnette avec à côté, entouré d'une barrière de clayonnages, un carré où elle fit pousser des courges précoces et des haricots en été, et des choux de Géorgie (roses trémières des potagers) en hiver. Le terrain de Jane était sur la terre ferme, dans la pinède plate parsemée de blocs de ces palmiers-scies vert foncé à l'aspect tropical, et jouxtait l'entrée bordée de marais […] au-delà de laquelle, à cinq cents mètres de distance, s'étendent la vaste plage ouverte sur l'océan, les dunes de sable qui ondulent et les buissons de chêne nain et de cèdre de « l'Île ». Là, bien à l'abri au creux des fourrés et sous l'épaule protectrice des collines, on trouvait les résidences d'été des Îliens et là aussi, juste en face de la maison de Jane, se trouvait l'hôtel où, tous les jours d'été, elle faisait frire les merlans, bouillir les têtes de moutons (5), farcissait les crabes et faisait diverses autres choses avec les ressources de la mer que les pêcheurs apportaient régulièrement dans sa cuisine. Les droits de riveraine de Jane lui permettaient un mouillage où, amarré à une petite digue de pierre rudimentaire, elle garait la barque à fond plat dans laquelle elle traversait, matin et soir, les eaux calmes séparant sa maison de son lieu de travail. Ésaü, un Noir de peu d'envergure et de piètre apparence, encore assez jeune, menait une existence facile en pêchant, ramassant des crabes et faisant divers petits travaux pour les gens de l'Île. Il avait l'esprit d'aventure, comme la plupart des Noirs de l'Océan, et souvent, au petit matin, il menait sa yole percée au milieu des brisants à l'embouchure de la passe, puis en ramant (ou, quand le vent était favorable, poussé par le chiffon de sa voile), il s'aventurait en mer jusqu'à une dizaine de kilomètres de la côte, jetait une ancre faite de deux pots de fer de récupération attachés ensemble, et pêchait jusqu'à midi au-dessus des rochers des poissons noirs, sous le soleil brûlant, revenant sur le rivage pour vendre les meilleurs poissons aux Îliens et, après, mangeant lui-même les rebuts et les restes. Les autres jours, quand le vent d'est lui disait que le poisson ne mordrait pas, il s'embourbait dans les petites criques et les ruisseaux du marais ou le long du lagon, et prenait des crabes à pleins paniers, qui, en général, trouvaient facilement preneurs. Comme il apportait souvent son poisson à l'hôtel, Ésaü avait l'occasion de converser agréablement avec la vieille Jane, et elle lui donnait souvent de bons morceaux de nourriture de Blancs tombés d'une table trop remplie. En retour de ces amabilités gastronomiques, Ésaü coupait des bûches, préparait du petit bois et faisait d'autres travaux masculins que les jeunes Noirs chevaleresques exécutent fréquemment pour une femme en dehors de leur cercle familial. Un chaud matin d'août, Ésaü rassembla ses lignes et appâta dès qu'il fit suffisamment jour et, franchissant la passe peu profonde à l'embouchure du lagon, il rama paresseusement jusqu'à arriver au-dessus des rochers. C'était une aurore sans vent, la mer était sans une ride, et les vagues qui se soulevaient lentement réfléchissaient les teintes opalescentes du ciel à l'orient. La marée était encore descendante et sa force, augmentant la vitesse du bateau, l'amena rapidement à son point de largage, où il jeta l'ancre. Le bateau tourna lentement, dirigeant la proue vers la terre, pendant qu'Ésaü, à la poupe, s'assit le dos tourné au soleil levant, et jeta ses lignes. Le poisson mordit bien, et au bout de deux ou trois heures, le fond du bateau d'Ésaü était entièrement couvert des prises scintillantes, principalement truites de mer tachetées, merlans et poissons noirs. Le soleil se fit plus chaud, et Ésaü piqua du nez, somnola et finit par s'endormir, bien que, l'inversion de la marée ayant fait tourner l'avant de la barque vers le large, le soleil lui brûlât maintenant le visage. À la fin, vers midi, quand les rayons tombèrent droit sur sa tête crêpue, il se réveilla en sursaut : un gros maquerau avait sauté hors de l'eau assez près de lui pour l'éclabousser. Il jeta un coup d'œil sur une mer semblable à de l'argent en fusion. Un grand requin, aussi long que son bateau, remonta lentement des profondeurs juqu'à quelques dizaines de centimètres de la surface, et, restant sans bouger, le regarda de ses yeux froids, dépourvus d'expression. Ésaü frissonna. Grand Dieu, murmura-t-il, il est temps de rentrer ! et tandis que la sinistre créature disparaissait dans les profondeurs de l'océan, il releva rapidement l'ancre, attrapa les avirons et rama vigoureusement vers le rivage. La marée était haute quand il atteignit l'entrée ; il franchit les longs rouleaux au-dessus de la passe et aussitôt tourna le nez de son bateau vers le rivage sur les coquilles d'huîtres de l'amarrage. Il attacha ses poissons le long de ficelles et descendit pour chercher un marché, mais le temps perdu à dormir avait fait qu'il était trop tard pour pourvoir au repas de ses clients habituels, et, comme maintenant son poisson n'était plus frais, il n'avait plus d'autre recours que de le manger lui-même ; il se mit donc à le nettoyer et une heure plus tard, alors que Jane, après avoir servi le déjeuner de l'hôtel, mangeait seule dans la cuisine, Ésaü apparut et demanda poliment qu'elle lui prête une poêle à frire. — S'il vous plaît, madame ; et puis un peu de graisse pour la graisser. Comme ni la graisse ni le combustible ne coûtait quoi que ce soit à Jane, elle accepta généreusement, avec cette magnanimité qui pousse tant des nôtres à ne pas regarder à la dépense quand ce sont les autres qui payent. Ésaü frotta la couenne de lard bien grasse sur le fond large et généreux de la poêle à frire de l'hôtel et, quand il l'eut suffisamment enduite, il y jeta ses poissons ; le bruit et l'odeur horribles de la friture remplirent aussitôt les oreilles et les narines de tout le monde dans l'établissement. Ésaü fit frire et il fit frire encore, jusqu'au moment où, ayant rempli un grand plateau avec ses poissons, il suspendit la poêle, décrocha son appétit et commença à manger. Ésaü était un mangeur, et son art ne connaissait pas la demi-mesure. Saisissant un poisson par la tête et la queue, il le promenait latéralement le long de sa bouche, comme certains voyageurs le font avec des épis de maïs vert, ou comme le Nègre du village joue de l'harmonica, jusqu'à ce que, le temps d'un clin d'œil, il ne restât plus que des arêtes dans ses doigts graisseux ; alors, il jouait d'un autre harmonica, jusqu'à s'en être mis plein jusqu'au cou en quelques minutes – il ne restait plus que dix à douze truites grillées, qu'il cacha avec la vieille Jane, pour s'en occuper plus tard, et s'en remit à l'ombre d'un grand chêne broussailleux voisin pour se reposer. Il se jeta sur le sable et dormit plusieurs heures comme un anaconda repu. À la fin, vers le coucher du soleil, le vent de la terre apporta des moustiques de la terre ferme à travers le lagon, et ils grouillèrent au-dessus de lui. Pendant qu'il s'agitait dans son sommeil troublé, certaines des aubépines qui poussent partout sur les sables de l'île firent leur chemin au travers de son pantalon en toile fine et le piquèrent, ce qui le réveilla. Il se leva, grincheux et bougonnant, et retourna à la cuisine où Jane préparait déjà le dîner. — Eh ! où es-tu allé, Ésaü ? lui demanda-t-elle en guise d'accueil. — J'étais allé dormir, madame, mais les moustiques et les aubépines et tout le reste m'ont réveillé et m'ont fait me lever. — Qu'est-ce que tu vas faire du poisson que tu as laissé, Ésaü ? Les Blancs ont fait dire que les poissons les gênaient et ils m'ont dit de les jeter dans la rivière. — J'ai eu du mal pour les manger tous à la fois ; mais je ne voudrais pas avoir à les jeter dans la rivière. Ésaü se glissa vers le plateau de poissons et, les regardant avec regret, il en arracha avec les doigts quelques morceaux à grignoter, et les porta à sa bouche. — Tu ferais mieux de jeter ça, Ésaü. lui conseilla Jane qui s'activait à sa tâche. — Oui, madame, je les jetterai plus tard. Je ne les mange pas, je les grignote juste. Et il partit lentement vers le lagon, avec le plateau sous le bras, mais, tout en marchant, il grignota si bien les poissons que, quand il arriva au bord de l'eau, il ne restait pas grand chose en dehors des arêtes. Deux heures plus tard, Jane alla voir la maîtresse de maison avec un visage anxieux. — S'il vous plaît, madame, donnez-moi du gingembre et d'autres choses pour les donner à Ésaü avant qu'il ne soit mort. Pour sûr, ce garçon a un énorme appétit pour manger de la nourriture. Il a pris tous les poissons, il ne pouvait pas les vendre aux Blancs parce qu'ils étaient restés toute la journée au soleil. Et il les a fait frire et en a mangé lui-même trois ficelles, et il a laissé une ficelle pour plus tard, et je lui ai dit de jeter cette ficelle-là, et il est parti la jeter, mais les poissons pleuraient en suppliant Ésaü, et Ésaü les entendait pleurer, et il les a grignotés, et il a continué à les grignoter, les grignoter encore, jusqu'à ce qu'il ait mangé presque tous les poissons, et maintenant, c'est les poissons qui le mangent ! J'ai une bouteille de pommade équine, pour frotter les chevaux. Je lui en ai donné, mais la bouteille n'était qu'à moitié pleine, et j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de pommade pour lui faire du bien, bien qu'elle étouffe Ésaü quand il l'avale, et elle le fait cracher comme crachent les crabes. Maintenant, il se roule sur le sol, encore et encore, comme le mulet le dimanche, et vous pouvez l'entendre gémir comme la femme gémit à la veillée, quand son mari est mort, etc. S'il vous plaît, madame, pouvez-vous me donner de la pommade, ou n'importe quoi à lui donner ; peu importe si c'est du pétrole (6), parce que ce garçon va mourir ! — Que voulez-vous, Jane, du gingembre, de la menthe poivrée ou du whiskey ? — C'est quoi le dernier dont vous avez donné le nom, madame ? — Du whiskey. — Madame, c'est trop précieux pour le jeter si ce garçon devait mourir. Si vous n'avez pas de pommade, madame, s'il vous plaît, donnez-moi le gingembre et la menthe poivrée, les deux, pour que je puisse les jeter dans Ésaü. — Ne lui donnez pas trop de choses, Jane, une suffit. — Madame, est-ce que ce garçon n'a pas mangé quatre sortes de poissons ? Je veux lui donner des remèdes pour atteindre toutes les sortes de poissons qu'il a mangées. Je ne veux pas qu'il meure entre mes mains, parce qu'il n'a pas de famille, et qu'il n'appartient à aucune société qui pourrait s'occuper de son enterrement, et je sais très bien que je ne veux pas dépenser mon argent à acheter un linceul, un cercueil et tout le reste pour Ésaü. Alors, s'il vous plaît, madame, faites vite, donnez-moi le produit pour le lui mettre et voir si je peux lui sauver la vie ! Une large dose de gingembre et de menthe poivrée fut versée dans une tasse en étain, dont Jane plaça de force le bord entre les dents d'Ésaü, et elle le fit boire si bien qu'en quelques minutes, il s'agitait sur le sol comme un poisson qu'on vient de sortir de l'eau. Ses spasmes furent cependant de courte durée, et il resta allongé dans un état de demi-inconscience. Jane était ravie. — Madmae, vous et moi, on a sauvé la vie d'Ésaü. Ce garçon nous appartient, à vous et à moi, et je vais le mettre au travail. L'été déboucha sur un automne précoce. Les jours raccourcissaient. Les soleils de septembre brûlèrent sur le maïs mis à mûrir et, à travers les nuits qui s'allongeaient, de lourdes rosées tombèrent sur l'herbe aux jupons violette et sur les boutons d'or. Entre le coucher du soleil et le crépuscule, les canards d'hiver s'envolaient de leurs terres nourricières vers leurs perchoirs dans les étangs des pinèdes et toute la nuit bruissait du petit « touit touit » des merles traversant pour rejoindre leurs quartiers d'hiver. Ainsi Jane, au dernier été de ses jours, jeta un regard bienveillant sur l'homme qu'elle avait sauvé, bien qu'elle n'ait pas accordé beaucoup de prix à ce sauvetage, et Ésaü, petit à petit, prit l'habitude de rôder dans sa cuisine, et d'accepter le regard de propriété qu'elle jetait sur lui, cassant du bois et faisant d'autres petites tâches pour elle, comme si ça allait de soi. À la fin, un jeudi soir vers la fin du mois, Jane se présenta timidement devant sa patronne, tenant un coin de son tablier devant un coin de sa bouche, qui s'élargissait d'une oreille à l'autre. — Patronne, je viens vous dire, madame, que je vais épouser Ésaü. Ce garçon tournicote dans la cuisine jusqu'à ce que mon chemin croise le sien. Je ne peux pas me déplacer sans tomber sur lui. Alors, je vais le prendre comme mari. Cette annonce causa quelque agitation parmi les dames de l'hôtel, et, comme Jane avait fixé le mariage au samedi suivant, elles se hâtèrent de visiter leur garde-robe pour y trouver de quoi parer la mariée. Une vieille mousseline à points suisses, plus ou moins oubliée, fut proposée par sa propriétaire comme quelque chose de doux et virginal, avec quoi mâter le vaisseau qui avait sillonné les sept mers du mariage. Une autre dame de l'hôtel proposa une paire de bas blancs et, comme Jane désirait un voile, un pan d'une ancienne moustiquaire, fortement amidonné et nettoyé avec soin, compléta le costume. Le samedi soir, une heure après le dîner, Jane, conduite par Ésaü et accompagnée du locus pastuh (le prédicateur de l'église locale) fit son apparition devant la compagnie de l'hôtel rassemblée sur la placette, et annonça qu'elle était prête à se marier. Le voile en moutiquaire avait été disposé par certaines des dames pour former une boucle artistique, et les points suisses l'enveloppaient de leur raideur amidonnée. Le nœud fut bientôt fait, et Jane, portant le gâteau de mariage dans ses bras et suivie par son nouveau mari, s'élança comme irait sur les flots un brigantin encrassé rempli de charbon étrennant une voilure réassortie. Le matin suivant, Jane apparut dans la cuisine plus tôt que d'habitude. La patronne de l'hôtel lui demanda ce qu'elle avait fait de son nouveau mari. — Je l'ai chassé. Je n'en veux plus. Qu'est-ce que je ferais d'un homme ? Je n'ai pas de fortune ! J'ai épousé Ésaü pour avoir un mari, je ne l'ai pas épousé pour avoir un homme ! Les Noirs qui ont grandi depuis la libération ne valent rien ! Je l'ai épousé, alors je le renvoie ! — Pourquoi alors l'avoir épousé, si vous n'en voulez pas ? — Pfff ! Madame ! Je l'ai épousé pour faire taire toutes les autres femmes ! Vous croyez que je veux qu'elles m'appellent vieille fille ? |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Notes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
u Le malœil | (1)____________The Plat-eye (pages 183 à 189) |
Tous les Noirs du Bas Pays croient plus ou moins aux esprits (sperrit ), fantômes (haant ) et autres apparitions mystérieuses, mais le malœil, propre à la côte de la région de Georgetown, est le plus étrange et le plus terrifiant qui s'en prenne aux Noirs se promenant la nuit. Le malœil apparaît aux vieux comme aux jeunes, d'un ou l'autre sexe, sous la forme d'un petit chien ou d'un autre animal, alors qu'à d'autres moments, il peut flotter comme un spectre le long des marécages ou des chemins abandonnés, ou descendre comme les nuages bas et envelopper sa victime. Plus souvent, cependant, le malœil apparaît sous la forme d'un animal familier qui, regardant son propriétaire avec des yeux de feu, lui saute dessus, le pétrifiant de peur, et, juste quand l'humain s'attend à voir ses organes vitaux déchiquetés, l'apparation s'évapore, et le propriétaire tremblant continue sa route au plus vite. Certains affirment que, dans certains cas, ceux à qui le malœil était apparu s'étaient endormis en marchant et, vivant ces terreurs en rêve, s'étaient réveillés pour s'apercevoir qu'il était parti. Cependant, quelle que soit la forme qu'il ait prise, les Noirs craignaient sa rencontre, tout comme les loups garous étaient craints en Europe il n'y a pas si longtemps. De son côté, la vieille Jane, (2) […] croyait au malœil aussi fermement qu'elle le craignait. Partout et toujours, quand elle marchait la nuit, elle le guettait et l'attente de son apparition subite laissait ses nefs dans un agréable état de tension. Un veau errant au bord de la clairière, un raton laveur se promenant sur un chemin forestier, un lièvre surgissant devant elle, le grand-duc faisant s'envoler ses poules rétives de leur perchoir fugitif sur le faîtage de sa maison, même les crabes de sable fantomatiques qui glissaient le long des plages la nuit, aussi lumineux que l'écume soulevée par le vent, chacun était un malœil en puissance ! Deux semaines avaient passé depuis que Jane, ayant renoué avec le célibat, avait privé l'éphémère « mari de son cœur » du gîte et du couvert auxquels, selon les usages des gens de couleur à défaut des lois de l'État, il était supposé avoir droit. Ésaü alla à droite et à gauche, poursuivant ses occupations nomades habituelles, mais vaguement conscient de son statut marital passablement flou […]. Jane (à qui le mariage avait apporté en théorie le statut d'épouse, et en pratique des choses très concrètes avec le point suisse et les bas blancs de sa tenue de mariée – disposant de plus de ses biens et de sa personne aussi librement qu'elle l'avait fait avant cet épisode) se trouva gagnante et, par esprit de justice, regarda plutôt Ésaü comme une innocente victime. Ésaü, cependant, n'était pas complètement perdant. Durant sa tentative de cour ou plutôt, pendant que, sans qu'il le sût, Jane l'avait pris en considération, il avait coupé du bois et fait d'autres petits travaux pour elle sans attendre de compensation particulière, puisque Jane était alors pour lui une étrangère et qu'il lui accordait de son propre chef ces marques de galanterie. Mais une fois le mariage célébré, bien qu'elle eût divorcé sans délai ni cérémonie, ou l'eût mis dehors, elle était encore sa femme – et en pensée au moins, son bien – et, par un retour à ses ancêtres africains, il se dit que les femmes étaient d'abord faites pour casser le bois et puiser l'eau, les servantes de leur seigneurs de maris ; aussi, avant de prendre en main une hache ou de se baisser pour ramasser des copeaux ou du bois flotté, ne manquait-il jamais de marchander avec la cuisinière ce qu'elle lui donnerait en échange, à titre de dépense de la maîtresse de maison . — Ésaü, s'il te plaît, pourrais-tu me ramasser un peu de petit bois pour que j'allume mon feu. — Qu'est-ce que vous me donnerez ? — Pourquoi devrais-je te payer pour m'apporter du bois, Ésaü ? — Est-ce que je ne vous ai pas prise pour épouse ? Pourquoi un mari aurait-il à apporter du bois à sa propre femme ? — Je t'ai épousé, c'est vrai, Ésaü, mais est-ce que je ne t'ai pas renvoyé ? et maintenant, n'es-tu pas exactement comme tous les autres hommes avec qui je n'ai jamais été mariée ? Ésaü se gratta la tête ; la question était plutôt ardue pour son intelligence, mais il n'en grommela pas moins avec obstination : — Un homme a une épouse pour qu'elle lui fasse à manger, non ? Comment une femme peut-elle préparer de la nourriture sans qu'elle coupe du bois ou en ramasse pour faire du feu ? Non, madame ! Qu'est-ce que vous me donnerez à manger si je vous coupe du bois ? Et ainsi, à chaque fois qu'Ésaü coupait du bois, la cuisine de l'hôtel payait la note. Septembre passa en brûlant. Vint octobre. […] Les longs rouleaux se heurtaient à la grève et se brisaient en des projections semblables à de la dentelle que le vent marin jetait en un millier d'arcs-en-ciel en miniature. Le cri plaintif des oiseaux de mer, le sifflement de la folle avoine quand les aigrettes de ses graines mûrissantes bruissaient dans le vent, et l'odeur piquante dans l'air, apportaient à l'esprit la tristesse poignante de l'automne – Feuille qui tombe et Arbre qui s'estompe (3) et la mélodie obsédante de Tosti. Un soir, Jane laissa Ésaü l'accompagner pour se rendre dans une maison à quelques kilomètres en haut de la plage, où elle devait faire une course pour sa patronne. La nuit était noire et le ciel, couvert […]. Comme elle s'éloignait des lumières rassurantes de l'hôtel et s'aventurait dans l'obscurité plus angoissante qui s'étendait devant elle, Jane frissonna, et releva son châle de ses épaules sur sa tête qui portait un bandana, comme pour isoler ses oreilles inquiètes de tous les bruits terrifiants. Ésaü marchait à ses côtés mais lui aussi était mal à l'aise, car c'était un garçon timide, et même les plus courageux ne sont pas trop braves, la nuit. Soudain, une rafale de vent souleva la crête d'écume d'une vague qui se brisait, la leur envoya au visage et siffla sinistrement dans la folle avoine. Un crabe-fantôme surgit sous leurs pieds et détala, effrayé. Jane attrapa le bras d'Ésaü. — Grand Dieu ! grogna-t-elle, Un malœil ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! — Où-où ça ? bégaya son accompagnateur effrayé mais moins imaginatif. Mais avant qu'elle ait pu désigner le crabe volant, une autre créature blême, ayant l'aspect d'une araignée, traversa son chemin et suivit la première. Jane était prête à s'envoler, mais Ésaü s'accrocha et la calma ; quelques instants plus tard, ils se remirent en route, mais les yeux largement ouverts et le pas hésitant. Ils finirent par couvrir la moitié de la distance, et à deux kilomètres, au-delà de l'obscurité, un point jaune lumineux marqua leur but. Ils l'auraient sans doute atteint, s'il n'y avait eu l'amour du raton laveur pour les crustacés. À un point bas de la vaste plage, la marée avait creusé un étroit canal à travers lequel les eaux s'étaient précipitées presque jusqu'aux dunes, entraînant des petits poissons, des crevettes et des palourdes loin au-delà des rouleaux et, à l'entrée de cette entaille, faisant face à l'océan, un gros raton laveur était en train de pêcher au moment où nos deux personnages atteignaient le ruisseau créé par la marée et s'arrêtaient pour se préparer à le traverser. Ésaü, le pantalon remonté jusqu'aux genoux, s'engagea le premier ; restée sur le bord, « debout sur des pieds hésitants », Jane l'appela pour l'interroger sur la profondeur ; c'est alors qu'elle tourna malencontreusement les yeux vers la mer, juste quand le pêcheur à quatre pattes, surpris par les voix derrière lui, faisait demi-tour et tounait ses yeux ronds et verts droit dans leur direction. Quand leur sinistre lueur brilla horriblement sur le fond sombre des vagues, Jane hurla comme à l'agonie : — Oh ! Jésus ! le malœil ! le malœil !Et, faisant volte-face, elle s'enfuit sur le chemin du retour, criant à chaque pas. La galanterie d'Ésaü et un bref regard vers les yeux brillants le poussèrent à suivre Jane, ce qu'il fit aussi vite qu'il le put, tandis que le pauvre raton laveur, dérangé dans son repas par le désordre dont il était la cause involontaire, ne perdait pas de temps pour regagner son abri dans les fourrés au-delà des dunes. Jane accéléra. Ses hurlements cessèrent au bout d'une centaine de mètres et, en dehors de sa respiration difficile, elle courait en silence, Ésaü, ombre noire, la suivant de près. En un rien de temps, elle et son coéquipier arrivèrent à l'hôtel, sans voix mais épuisés et apeurés. Quand elle eut retrouvé son souffle, Jane se précipita vers sa patronne. — Patronne, madame, je n'ai pas eu la réponse au message que vous avez envoyé à ce monsieur de l'autre côté de l'île, parce que je ne suis pas arrivée jusque là, patronne. Et, si Jésus m'entend, je n'irai plus jamais à cet endroit la nuit ! Patronne, les malœils s'accrochent à cette plage comme le crabe violoniste s'accroche au marécage quand la marée est basse ! Je suis allée avec Ésaü, et quelque chose est sorti du haut de la vague, et a flotté autour de moi comme un nuage avec un esprit à l'intérieur. J'ai fermé les yeux et je suis passée. Alors le vent s'est mis à sauter et il a commencé à remuer l'herbe et tout le reste en haut des dunes, jusqu'à ce que mes cheveux se dressent ! Au même moment, j'ai vu deux esprits blancs traverser la route. Ésaü tremblait, jusqu'à ce que je le saisisse par la manche pour l'empêcher de fuir, mais la chose n'a jamais eu une chance de jeter un œil sur moi jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit où la marée traverse la plage. Quand je suis arrivée là, patronne, Ésaü a roulé son pantalon pour traverser. J'attendais qu'il ait traversé avant de partir et relever mon jupon pour la traversée. Si Jésus ne m'avait pas dit de jeter les yeux pour regarder autour de moi, je ne serais pas ici ; mais quand j'ai regardé, j'ai vu les deux yeux de la chose briller, comme l'œil du bateau-phare brille au-dessus des hauts fonds de Rattlesnake (5) ! Patronne, quand j'ai jeté le regard sur lui, j'ai pensé que c'était le bateau-phare lui-même, mais ensuite, il a balancé la tête, et j'ai su que c'était le malœil, et il a essayé de me jeter un sort pour me faire mourir ! Je n'ai pas eu le temps de me mettre à genoux, mais j'ai commencé à prier dans mon cœur, et j'ai prié Dieu pour que, si le malœil devait attraper quelqu'un, il lui fasse attraper Ésaü et me laisse, parce que, patronne, tout le monde sait qu'Ésaü ne vaut rien ! Mais il semble que Dieu n'a pas entendu la prière, parce que j'avais la bouche fermée quand je l'ai faite, parce que je ne voulais pas qu'Ésaü entende ce que je disais. Le malœil n'a pas ôté ses yeux de sur moi. Il regardait et il regardait, et ses yeux devenaient de plus en plus gros et de plus en plus brillants, et quand j'ai vu qu'il me regardait et qu'il ne s'occupait pas d'Ésaü, patronne, je suis revenue à la maison ! Patronne, vous avez vu des chiens courir, vous avez vu de chevaux courir, vous avez vu des oiseaux voler, et vous avez vu des marsouins sauter dans la rivière, mais vous n'avez jamais rien vu filer comme j'ai filé quand j'ai commencé à courir. Quand mes dix orteils se sont enfoncés dans le sol, j'ai jeté du sable sur plus d'un demi-acre (5) derrière moi ! Le vent que je faisais soulevait au-dessus du sol la folle avoine, l'herbe et tout le reste ; pendant tout le temps où je courais, j'entendais les pieds d'Ésaü battre le tambour derrière moi, et quand je les entendais, je disais merci, parce que je savais que la chose l'attraperait d'abord, lui, avant de pouvoir m'attraper. Alors, patronne, si vous n'y voyez pas d'objection, madame, je vais reprendre Ésaü comme mari, parce que, depuis cette nuit, je sais que je peux courir plus vite que lui, et cela pourra être très utile quand j'aurai à me déplacer de nuit, parce que, si le malœil nous poursuit tous les deux, il sera obligé d'attraper Ésaü en premier, et, bien que ce garçon ne vaille rien, il a des pieds si lents, patronne, qu'il peut me sauver la vie. |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Notes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
i Le cerf et l'alligator | ____________Buh Alligettuh en' Buh Deer (pages 216 à 218) |
Contrairement aux précédents, ce récit est entièrement en gullah (1), sans introduction ni commentaires en anglais.
Jadis, quand il n'y avait ici que des oiseaux, des animaux et des Indiens, frère cerf et frère alligator n'étaient pas des amis : frère alligator tuait frère cerf et le mangeait à chaque fois que l'occasion s'en présentait ; c'est pourquoi frère cerf avait peur de traverser la rivière, et à chaque fois qu'il descendait boire sur la rive, il dressait les oreilles et plissait les yeux à cause de frère alligator avant de tremper sa bouche dans l'eau. Mais ensuite les Blancs sont venus, et, plus tard encore, les Blancs ont amené les Noirs, et ensuite, ils ont amené les chiens de chasse, et alors les Indiens sont partis, et les Blancs ont commencé à chasser frère cerf avec des chiens anglais, et les chiens étaient si rapides, ils serraient frère cerf de si près que la seule chance qu'il avait de se sauver était de traverser l'eau, malgré frère alligator ; ainsi, que la rivière soit proche ou lointaine, frère cerf y allait à chaque fois que les chiens lui sautaient dessus. Cette fois-ci, la première fois que les Blancs chassèrent frère cerf avec des chiens de chasse, frère cerf n'y était pas habitué ; il était couché dans son lit dans un buisson de myrtilles au bord d'un champ de genêts pour se reposer, jusqu'à ce que les chiens manquent de peu de l'attraper et qu'il ne puisse pas se cacher ; il se précipita hors des myrtilles et visa la rivière […] ! Frère cerf avait peur. Il sauta. Il courut. Et il arriva le premier. Juste quand il atteignait le promontoire pour sauter dans la rivière, les deux yeux de frère alligator sortirent de l'eau pour l'attendre ! L'alligator avait faim : la nourriture se faisait très rare, son ventre le tiraillait ; frère cerf était gras, il était gras à souhait. Frère cerf se trouve alors dans une situation très difficile : il a l'alligator devant lui et les braques derrière ; leurs cris traversent les marécages et se rapprochent vite. Que faire ? Il a l'alligator sous les yeux, les braques dans les oreilles. Aussi fait-il un brusque écart juste avant que les chiens ne le découvrent, et il descend à toute vitesse le long de la rivière sur environ sept acres à partir du promontoire, puis traverse la rivière à un endroit où frère alligator ne le voit pas. Alors les braques arrivent à toute vapeur vers le promontoire. Ils arrivent si vite sur la trace de frère cerf qu'ils ne s'arrêtent pas, et deux ou trois vont sur la rive et tombent dans l'eau près du museau de frère alligator. Frère alligator se dit en lui-même : « Qu'est-ce c'est que ça ? Je n'ai jamais vu d'animal de ce genre mais ça me fera à manger ! » Et il attrape l'un des braques et l'emmène sous l'eau. Les autres sortent de l'eau, prennent leurs pattes à leur cou et rentrent chez eux. Frère cerf s'en est tiré cette fois-ci. Il est sauvé ! Quand il est prêt à retraverser la rivière, il regagne tranquillement la rive en ouvrant bien les yeux pour frère alligator ; et un peu après, il le voit allongé dans la vase d'une berge, en plein soleil. Son ventre est rempli de viande de braque. Il est repu. Il dort. Frère cerf se faufile vers la rivière pour pouvoir la traverser, mais avant qu'il n'ait pu mettre une patte dans l'eau, frère alligator l'a vu et glisse de la berge pour aller à sa rencontre. Voilà le diable, à présent ! Comment frère cerf peut-il traverser pour aller retrouver sa famille ? Il se met à réfléchir, mais avant qu'il n'ait pu ouvrir la bouche, frère alligator entame la conversation : Frère alligator lui répond : Voilà pourquoi, depuis la conclusion de ce pacte, à chaque fois qu'un chien le poursuit, frère cerf prend la rivière, et frère alligator le laisse passer, puis, quand le braque arrive, il le saisit ; mais si frère cerf vient à la rivière sans chien derrière lui, alors, c'est à ses risques et périls. |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Notes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
o Au tribunal de Toogoodoo | (1)____________The retort courteous (pages 223 et 224) |
Elle s'appelait Patty. […] Elle se présenta devant un tribunal de première instance de la Côte comme témoin à charge dans l'affaire l'État de Caroline du sud contre Cudjo Manigo , où ce dernier était pousuivi pour des actes malveillants et préjudiciables. S'étant approchée pour témoigner, elle pencha la tête d'un côté et sourit complaisamment jusqu'à ce que les coins de sa bouche […] approchassent dangereusement de ses oreilles. Tordant sa moustache (2) couleur d'ambre, le juge commença : R– Madame Wineglass, monsieur. Q– Où est votre résidence ?R– Elle n'a pas pu venir aujourd'hui, monsieur. Q– Je veux dire : où habitez-vous ?R– Oui, monsieur. J'habite sur la plantation de maître Kit Fitzsimons (3), qui l'a achetée le mardi de l'avant-dernière semaine d'il y aura bientôt six mois ; et je suis bien contente, moi aussi, qu'il l'ait achetée parce que, dès qu'il l'a eu achetée, il a mis dehors mon dernier mari, que j'avais épousé en août, que moi et ce garçon, on n'était d'accord sur rien. Parce que, en premier lieu, il aimait trop cogner sur sa dame ; ensuite, en second lieu, il était d'une paresse rare, et ne valait rien ; en troisième lieu, sa première épouse et moi, on n'a jamais pu s'entendre ; puis, en quatrième lieu, il est marguillier (5) de l'église baptiste, et tout le monde le sait bien, qu'un marguillier fait un très mauvais mari pour sa propre épouse ; ensuite Q– Ça ira. Quelle est votre charge contre le défendant ?R– Frère Cudjo, monsieur ? Q– Oui, quelle est votre charge contre lui ?R– Je ne lui ai jamais donné aucune charge, monsieur. Q– Bon. Qu'est-ce qu'a fait Cudjo ?R- B'Cudjo est un garçon très incorrect, monsieur. Il est le marguillier dans mon église, et quand le prédicateur du circuit ou bien le pasteur local ne peuvent pas tenir le pupitre, c'est B'Cudjo qui assure le service à l'église ; et quand B'Cudjo explique la Parole du Seigneur, il aime beaucoup avoir des mots doux avec les sœurs du sexe féminin, à l'église ; en plus, chaque fois qu'il me rencontre sur la route, il me demande de l'embrasser, et je ne veux pas embrasser un garçon aussi laid, à la bouche tordue, comme B'Cudjo, et je le lui dis ; alors, il m'injurie grossièrement. La dernière fois que je l'ai rencontré sur le chemin, il m'a posé plein de questions, et je lui ai dit « va-t'en, B'Cudjo » parce que je ne voulais pas entendre plus longtemps de tels propos, et pourtant B'Cudjo a continué sur mon chemin, et il a continué à me poser ce genre de questions, et ce que je sais surtout, c'est qu'il m'a lancé une insulte très méchante. Q– Quelle insulte vous a-t-il lancée ?R– Il m'a dit que j'avais la bouche aussi large que la rivière Ashley (5) ! Q– Et quoi d'autre ?R– C'est tout ce qu'il a eu l'occasion de me dire, parce que je lui ai dit : « Écoute-moi bien, B'Cudjo, devant le Seigneur, si ma bouche est comme la rivière Ashley, tu n'es même pas capable de la traverser à la rame avec ton bateau » ; alors, il s'est mis en colère et m'a frappée avec le manche de sa bêche, et voilà pourquoi je l'ai amené ici. À ce stade de la procédure, le tribunal de Toogoodoo ajourna sa séance pour aller mesurer la largeur de la rivière Ashley. |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Notes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
a De Columbia, en diptyque | The cat was crazy (pages 225 à 229) |
Deux récits pour le prix d'un : d'abord celui du banquier rêveur (en anglais) puis celui des deux Jane (en gullah).
Un dimanche après-midi, il y a peu, un prêcheur itinérant au gosier d'airain s'était arrêté au coin de Richardson et de Plain Street, à Columbia, chantant des hymnes dans l'intention louable de sauver une âme ou deux. D'une chambre des derniers étages du Grand Hôtel Central, un visage agréable regardait au dehors, vers l'ouest, tandis qu'un enfant tapotait sur la vitre. À une fenêtre opposée, un jeune banquier célibataire sirotait son cocktail du dimanche, tandis que ses yeux portaient un regard critique sur les passants qui revenaient de l'église. Combien de leurs secrets financiers détenait-il ! Combien de leurs obligations étaient à l'abri dans ses coffres ! […] Pensant, avec un soupir, que des robes plus courtes auraient permis des comptes en banque plus étoffés, il tourna les yeux vers les collines boisées de Lexington, au-dessus desquelles brillait le soleil, ce grand disque d'or. Mentalement, avec ses cisailles à coupons, le financier découpa l'astre du jour en bons du trésor, les plaça à intérêts (composés, bien sûr) et, avec un verre de vermouth supplémentaire pour l'aider dans ses calculs, il fut, en un rien de temps, à la tête de la fortune de Monte Cristo. Maintenant, le monde et tout ce qu'il y avait au-delà lui appartenait ! Sur les ailes de sa rêverie, il partit au loin, jusqu'en Arcadie. Mais au lieu de mener des taureaux et des ours, il avait maintenant un troupeau de brebis. Comme Stréphon, il jouait de la flûte, tandis que les agnelets gambadaient à ses pieds ou se blottissaient les uns contre les autres au grand soleil, « si chauds et endormis et blancs » (1) Couronnée de roses, la bergère le mena par des tonnelles couvertes de feuillage jusqu'à une clairière où, parmi les boutons d'or et les pâquerettes, il s'endormit et rêva. Ay ! Dios ! Combien peu d'entre nous réalisent, avant qu'il ne soit trop tard, que les plaisirs les plus simples sont les meilleurs, que notre maison et nos amis peuvent nous offrir beaucoup plus de bonheur que tout ce qui est au dehors. Combien d'entre nous réalisent qu'il y a plus d'exaltation dans une promenade de dix kilomètres que dans un quart de champagne, que mieux vaut le bruissement d'une courte jupe de coton en Arcadie (si nous faisons partie de l'Arcadie) que le frou-frou d'une traîne de satin dans un salon à Paris ! Mais le banquier rêvait, et les accents de la valse de Santiago (2) étaient dans ses oreilles, et les houris de Mahomet (3) glissaient devant lui, enveloppées de leurs sourires. L'une, plus avenante que les autres, lui fit signe, et il la suivit, encore et encore. Dehors dans l'obscurité, il suivit le reflet d'or de sa belle chevelure passée au bicarbonate, il la suivit dans l'enchevêtrement d'une forêt et les péils d'un marais – hélas ! le feu follet ! D'un coup, il se réveilla de sa rêverie pour découvrir (comme la jeune fille partie au marché qui trébucha et cassa le panier d'œufs dans lequel avaient éclos tous ses espoirs) que son or avait disparu, car soudain la fine bordure de l'horizon fut tracée comme par un cimeterre au travers de la gorge du soleil qui sombrait, et en un instant, le ciel, de l'occident au zénith, fut éclaboussé de son sang ! Avec un frisson, comme s'il avait pris froid à rester assis devant les découvertes de son imagination, le banquier prit son chapeau et sortit dans la rue, où le prédicateur, ayant terminé la partie musicale de son service, exhortait le petit groupe qui s'était rassemblé autour de lui. Soudain, sur un côté de l'attroupement, un vieux Noir apparut, courbé par l'âge et le visage marqué par la peine. Il tenait par la main une petite fille noire d'une dizaine d'années. Elle avait les yeux arrondis par la peur, et, autour de ses jambes minces, une jupe déchirée de calicot rouge battait comme un drapeau maintenu à mi-mât, taché par les intempéries. Le vieil homme fit le tour du groupe, scrutant avidement chaque visage comme à la recherche d'une oreille compatissante dans laquelle déverser son chagrin. Ne trouvant pas ce qu'il cherchait, il se hâta vers le Parlement de l'État, traînant l'enfant derrière lui, jusqu'à ce que, devant un marchand de journaux, il vît un homme ventripotent avec l'air d'un prêtre, parlant à quelqu'un de grand, à longue barbe, selon la vieille école. Devinant de la bienveillance dans le visage de l'un et l'autre, il s'approcha du plus petit et, d'une voix inquiète, demanda — Mon bon monsieur, s'il vous plaît, monsieur, dites-moi si un chat peut devenir fou. — Voulez-vous dire s'il est possible qu'il soit contaminé par un virus rabique ? — Non, monsieur, ce n'est pas une bique (5), c'est un chat. — Je présume, dit l'Anglais puriste, que vous désirez vous assurer s'il est possible pour un chat d'attraper la rage. Je dois dire, pour votre gouverne, qu'il y a (d'un point de vue lexical et mathématique) dix-huit formes de démence auxquelles l'humanité est sujette, allant de la folie émotionnelle du commerce à la mania a potu populaire, communément appelée delirium tremens. Je ne saurais donner une opinion générale confirmant ou infirmant la possibilité pour un chat d'avoir une ou plusieurs de ces sortes de démence, à moins que vous n'en décriviez précisément les symptômes et formuliez vos questions sans ambiguïté. C'est de toute évidence une affaire de surérogation. — Grand Dieu, monsieur !, dit le vieil homme, se tournant d'un air suppliant vers le personnage le plus grand. S'il vous plaît, monsieur, dites à ce monsieur que mon chat n'a jamais eu de bique, il a seulement eu des chatons. Oui, monsieur. La chatte s'appelle Jane, et elle appartient à cette jeune enfant qui est ma petite-fille, et elle (la fille) s'appelle Jane et Jane (c'est la chatte) appartient à Jane (qui est la fille) et Jane suit Jane partout où elle va, et Jane aime beaucoup Jane, et à chaque fois que Jane attrape un rat, elle l'apporte dans la maison, et à chaque fois que Jane a à manger, elle en garde toujours un peu pour Jane, et quand Jane (c'est la chatte) a eu neuf chatons dans le salon de Monsieur Clark (5), le troisième mardi de ce mois-ci, alors Jane (c'est la fille) s'est occupée pendant toute la nuit de Jane (c'est la chatte) et, à la grâce de Dieu ! monsieur, juste quand les chatons commençaient à ouvrir les yeux, un chien noir à la gueule tranchante, avec une queue dressée comme ces oiseaux exotiques que les femmes blanches aiment mettre sur leur chapeau quand arrive le dimanche, ce chien a sauté par-dessus la clôture et les a mordus ; Jane (c'est la chatte et la fille en même temps) a été très choquée, et bouleversée dans sa tête, et Jane (c'est la chatte) a sauté par-dessus la clôture et s'est enfuie ; alors le chien et Jane (c'est la fille) ont couru après Jane (c'est la chatte) jusqu'à ce que Jane (c'est la chatte) se mette à descendre la route. Jane (c'est la fille) voit le vieil oncle Bill Rose, qui était employé du Gouverneur, marchant tout comme il faut sur la route. Alors, la fille lui crie d'attraper le chat, mais tout le monde sait que l'oncle Bill Rose a comme qui dirait les jambes arquées et, bien qu'il ait serré les deux jambes, ses jambes n'ont pas suivi et Jane (c'est la chatte) a sauté juste entre les jambes du pantalon de l'oncle Bill Rose, et s'est enfuie et, à la grâce de Dieu ! elle a abandonné Jane (c'est la fille) et abandonné ses neuf chatons, qui n'avaient pas encore tous les yeux ouverts, dans le fumoir de monsieur Clark ; elle a filé, et a sauté par-dessus la clôture du terrain de l'asile, et c'est la raison pour laquelle je sais très bien que Jane (c'est la chatte) doit être devenue folle, puisque qu'elle s'est précipitée droit à l'asile ! |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Notes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
s Rien que des menteries ! | Waiting till the Bridegrooms (pages 233 à 237) |
Par une chaude journée de juin, il y a un an ou deux, un grand Noir, couleur de citrouille, menait tranquillement un mulet dénué de prétentions dans un champ de maïs de Basse Caroline. Il portait le nom mélodieux de Minzacter Singleton, et avait dans les cinquante-cinq ans. Pendant qu'il traçait dans un sens puis dans l'autre ses sillons, il sifflait joyeusement, car la terre brune qui ondulait en longues vagues au-delà de sa charrue était moëlleuse et fertile, et les maïs bourgeonnants qui se dressaient autour de lui en une grande armée industrieuse, aux uniformes bleu-vert, aux épaulettes de soie cramoisie et emplumés de pompons blancs, étaient pleins de promesse pour l'automne. […] Ce spectacle, toutefois, ne touchait pas Minzacter. C'était un réaliste, pas un poète ; et, conscient de son tiers d'intérêt dans la récolte, il prêtait beaucoup plus d'attention au choc de son sep contre les tiges de maïs qu'à la douce musique des harpes du vent qui s'élevait des larges feuilles quand un souffle d'air les traversait. Loin dans le ciel bleu, un corbeau volait lentement au-dessus du champ, tournant la tête d'un côté et de l'autre pendant qu'il menait une inspection critique du travail en cours ; et, trouvant que tout allait bien, il poussait de temps en temps un « craoh, craoh ». De même que le moine médiéval (modèle des compagnons en robe noire) prélevait d'une main onctueuse dans les champs de ses ouailles une dîme de ce qui serait engrangé, ainsi, quand les feuilles devraient être enlevées et que le soleil de septembre mûrirait les grains, ce « sukkus preechuh » revendiquait-il la rémunération de son intérêt pour (et de l'inspection de) ces cultures en cours. Comme l'ombre inquiétante passait entre le soleil et lui, Minzacter, regardant en l'air, dit : — Peu importe, mon frère. Fais attention que les vautours ne dansent pas à tes funérailles cet automne-ci ! Tu es assez intelligent pour savoir quand un homme a un fusil à la main, mais on ne t'a pas appris à distinguer quand les coquilles de maïs étaient empoisonnées. Aujourd'hui, tu tournoies haut dans le ciel, attention à ne pas voler bas avant que Noël n'arrive ! Quand il atteignit l'extrémité de son rang, l'attendait un robuste policier noir, envoyé par un tribunal de première instance voisin, accompagné d'une femme brune entre deux âges, qui, quand le laboureur s'arrêta, l'accosta avec un — Monsieur Singleton, je pensais que vous étiez un gentleman, mais j'en viens à penser que vous ne pouvez en revendiquer le titre, parce que vous êtes parti et m'avez laissée à la Rivière de l'Oie, et vous avez décampé pour épouser la grand-mère de Paul Jenkin, juste parce qu'elle avait quatre vaches et que je n'en avais pas. Vous êtes parti et avez abandonné votre épouse légitime, et je viens pour vous emmener au Palais de Justice pour qu'on vous envoie dans la prison de Walterboro. Avec une nonchalance visible, Minzacter dit : — Va-t'en, la fille ! Qui appelles-tu ton mari ? Je ne t'ai jamais vue depuis que je suis né. Je n'ai pas le temps de discuter du qui et du quoi avec toutes les femmes qui passent sur la route. Ce maïs a besoin de moi. Julia Singleton, la plaignante écrue , le quitta en le menaçant d'aller chez elle et d'apporter le « stercificat » pour prouver que Minzacter était bien son mari devant la loi. Sûre d'elle-même, le jour prévu pour l'audience préliminaire, elle apparut avec non seulement le certificat de mariage mais aussi son frère et le Rév. Sancho Middleton, le « locus pastuh » de la Rivière de l'Oie qui avait censément procédé à la cérémonie. Se retrouvant accusé de bigamie, Minzacter récusa avec indignation le moindre rapport avec cette femme. Le « stercificat » fut produit, mais comme on y lisait seulement « Je marie Monsieur Singleton à Madame Singleton », le juge fut d'avis que cela ne prouvait rien. Le frère de la plaignante et le prêcheur avaient été achetés pas un envoyé de Minzacter et, au dernier moment, ils revinrent sur leur témoignage à charge. Le frère fut appelé le premier, et Julia le questionna. — Mon frère, lui dit-elle, ne te souviens-tu pas qu'au mois de juin de cette année-là, quand nous avons déboisé ce nouveau terrain de l'autre côté des marais de Caw Caw, et quand sœur Frazier a eu des jumeaux, ne te souviens-tu pas que le pasteur m'a unie à cet homme ? — Je ne sais rien de cette histoire, dit le traître, je ne l'ai jamais vu depuis que je suis né, je ne connais pas son nom, ni son père, ni sa mère. Il y a plus d'un Noir couleur de citrouille qui vive dans ce monde. Les Noirs jaunes tapent sur le sol comme les parulines tapent sur les arbres, et, pour en revenir à cet homme-là, je ne l'ai jamais vu depuis que je suis né. — Monsieur le Juge, dit Julia d'une voix attristée, je viens rechercher mon mari, et mon mari ment. Je vais chercher mon frère Sam, et mon frère Sam ment. Je vais chercher le certificat, et le certificat ment. Maintenant, je vais interroger le pasteur de ma paroisse, et je sais bien que lui, ne mentira pas. Père Sancho, dit-elle en se tournant vers le patelin serviteur de Dieu, ne vous souvenez-vous pas quand sœur Frazier a eu ses jumeaux ? — Oh que si, ma sœur ! Je m'en souviens, parce qu'à ce moment-là, Joe, le petit de Nicodème Wineglass, qu'il avait eu de sa première femme, s'est fait prendre le pied dans un piège à loutre sur une terre de monsieur Fishburne, et le docteur a dû lui couper la jambe droite près du genou. — Bien, monsieur. Ne vous souvenez-vous pas que vous m'avez unie à cet homme-ci ? — Ma sœur, dit-il avec lenteur et componction, voyez-vous, c'est, pour votre pasteur, une affaire très délicate à examiner et discuter. Vous savez, pour le commun des Noirs, dire ceci puis cela est banal, mais le prêcheur est l'oint de Dieu, et, quand il ouvre la bouche, il doit interroger son esprit très scrupuleusement, surtout quand il parle avec une femme, parce que la femme est si trompeuse ! si vous n'y prenez pas garde, elle vous escamotera les deux yeux de la tête ; pour en revenir à cet homme, je dois comme qui dirait penser que je me souviens de peu de choses, du temps où je vous ai mariée à une sorte d'homme couleur de citrouille ; quand j'ai vu cet homme, au début, j'ai dû dire qu'il ressemblait plus ou moins à votre mari, mais quand j'en suis venu à l'examiner de près et à le voir en particulier, il me faut comme qui dirait penser que ce n'est peut-être pas votre mari. — À la grâce de Dieu ! dit Julia, au comble du désespoir. Je suis venue pour essayer de récupérer mon mari et je l'ai amené ici, et il ment. Puis je suis allée chercher mon frère et je l'ai amenée ici, et il ment. Alors, je suis allée chercher le certificat et je l'ai apporté ici, et il ment ; et, en final de compte, j'ai été chercher notre pasteur, je l'ai amené ici, et, devant le Seigneur, il ment. Maintenant, je retourne chez moi et je ramène les six demoiselles d'honneur(*) qui étaient à ce mariage quand j'ai épousé cet homme, parmi lesquelles ma sœur Amy – et je sais bien qu'elles certifieront que c'est mon mari. Aux dernières nouvelles, le Juge attend toujours leur venue. |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Note ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
d Lizzybet aux grands pieds | Conductor Smith's dilemma (pages 251 à 255) |
Pour ne pas laisser MSTS, Accro ou Dagon trop longtemps seuls, ce dernier récit quitte les champs de riz ou la salle du tribunal pour une voiture de chemin de fer.
Qui, parmi les millers de voyageurs ayant emprunté cette ligne, ne connaît pas et, le connaissant, n'apprécie pas le Chef de train Smith – Billy Smith, du Blue Ridge Railroad ? Certainement personne, car (comme son modèle Baines Carew, l'empathique avocat des Bab Ballads (1), qui était si rempli du récital des lamentations de ses clients qu'il « avait très rarement la force de réclamer ses honoraires ») Billy, la courtoisie et la gentillesse incarnées, n'encaissait jamais le prix d'un trajet ou n'oblitérait jamais un billet sans un sourire d'excuse et un regard de sympathie, comme s'il en pâtissait. Ce qui avait fait de lui la proie facile d'une clientèle exigeante. | 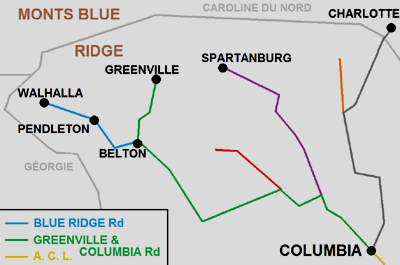 | |||
D'autres trains sont passés sur sa route, mais la crème du voyage avait toujours été réservée à Billy. À lui le bonheur de surveiller les jeunes têtes blondes envoyées rendre visite à quelque lointain parent ; […] à lui le privilège d'accompagner, à l'aller comme au retour, des dames qu'un destin prodigue avait bénies en les dotant de jumeaux, des dames avec des cages à oiseaux, des dames avec des poussettes pour bébés, des dames avec des chats dans des paniers, des dames avec des géraniums dans des pots, des dames avec des jambons faits-à-la-maison et des condiments dans des bocaux, des dames avec des paquets et des cartons à chapeaux, des dames animées du besoin impérieux de déverser dans son oreille complaisante leurs secrets de famille […] Avec ces confidences et d'autres de la même eau, le temps du patient chef de train filait entre les stations. Ainsi, pendant des années, Billy Smith avait-il avancé (ou plutôt s'était-il fait bringuebaler) sur le chemin du devoir entre Walhalla et Belton (2). Au printemps, quand ruisseaux et rivières sont gonflés par les fortes pluies […] ; en été, quand les abeilles s'empressent au-dessus des fleurs des trèfles et que le grain mûr tombe, balayé par la faux ; en automne, quand les châtaignes gisent sur le gazon et que les feuilles mortes tourbillonnent dans le vent ; en hiver, quand le Blue Ridge est enveloppé d'une robe de chambre de neige, et que les cristaux de glace, rejetés par la terre gelée, scintillent sur les bords des profondes entailles, en toutes saisons et par tous les temps, Billy Smith poursuit sa route. Le temps et les labeurs ont tracé des bandes grises dans sa barbe et creusé les rides sur son visage, mais son sourire est aussi doux et ses mains et ses pieds aussi bienveillants qu'aux temps de sa jeunesse ; tant qu'il ne devra pas mener son dernier train entre les portes de la nouvelle Jérusalem et présenter ses bordereaux pour être contrôlé par le Réviseur Tout Puissant, on le verra certainement aux terminus du Chemin de fer de Blue Ridge, chargé à ras bord, comme une péniche au dépôt de charbon, avec des bébés, des roquets, des plantes en fleurs et tout le bric-à-brac apparemment inséparable de l'itinérance féminine ; il prendra encore une stature de commandement au milieu de sa voiture et chantera chaque jour, hélas ! « cette vieille chanson douce (3) » : « Belton ! Belton ! Correspondance pour Columbia et la ligne de Greenville ! Environ cinquante minutes, cinquante minutes avant le passage du train pour Columbia ! Les passagers allant dans la direction de Columbia doivent descendre maintenant, vous devez descendre, car ce train repart dans environ dix minutes, dix minutes, pour Greenville, Greenville, qui est dans la direction opposée à Columbia ! » Il y a des moments dans la vie où les fleurs perdent leur douceur, et où les femmes ne sont plus charmantes ; où il n'y a pas de musique dans le chant des oiseaux, pas de gaieté dans le rire des enfants, et où le monde entier semble s'assombrir. Un de ces moments se présenta à Billy Smith l'autre jour, quand le chef de train Fielding, de la ligne principale, débarqua à Belton Diana Hawlback, une femme noire d'un certain âge, du comté de Beaufort, qui, avec sa petite-fille « Lizzybet », un cochon tacheté dans un sac, deux coqs de basse-cour et une poule, attachés par les pattes, quatre quarts de cacahuètes grillées, un cageot de patates douces « Jeanne la Folle », un grand stock de literie, et des bagages divers et variés, était en route vers Pendleton pour rendre visite à des parents. « Le combat s'engagea », comme disent les journalistes du Congrès, « au retour récurrent de la question précédente », qui était, en l'occurrence, la demande insistante du paiement d'un plein tarif pour la petite-fille de Diana, « Lizzybet », une adolescente aux longues jambes, à qui on donnait facilement quatorze ans. — Capitaine, dit Diana, cette fille est âgée de onze ans, et partout où je prends le train, les Blancs ne me font jamais payer plus que l'argent d'un enfant pour elle. Est-ce que vous ne vous souvenez pas, monsieur, de l'année où s'est produite la sécheresse aride ? Eh bien, cette fille est née cette même année-là, au milieu de l'été, parce que je me rappelle parfaitement que la sécheresse aride a asséché tous les marécages et toutes les mares et tout le reste en août, et tous les hommes sur la plantation sont partis dans les marécages et ont attrapé les alligators qui étaient tous sortis ; ensuite, la mère de cette Élizabeth (elle s'appelait Vénus) a mangé trop d'alligator quand Élizabeth avait trois semaines ; cette femme est morte, et m'a laissé la charge de cette fille. Le père de la fille était mon plus jeune fils, Polydore, et comme il est dit dans les Écritures, « Paul peut planter et Polydore peut arroser, mais Dieu fait l'homme qui donne la graisse. (4) » Toujours et encore, Polydore et son frère Paul plantent et arrosent tous les deux, jusqu'à ce que vienne la sécheresse aride, mais Dieu n'a pas envoyé la graisse jusqu'à ce que Polydore attrape l'alligator et le fasse cuire. Toujours selon la Parole des Écritures, il a donné à sa femme la graisse que Dieu avait envoyée, mais la femme est morte. Donc je ne pense pas que ce texte, que le pasteur m'a expliqué, puisse s'appliquer, ou alors je pense pas que le Père Kinlaw ne comprend pas très bien les Écritures, ou alors la graisse n'aurait jamais dû faire périr la femme. Lève-toi, ma fille, et laisse le Blanc regarder tes jambes. Capitaine, avez-vous jamais vu, depuis que vous êtes né, des jambes comme ça à une fille de quatorze ans ? Est-ce que vous ne savez pas, dit-elle tandis que le Chef de train Smith ouvrait des yeux aussi grands que les extrémités bipèdes qui lui étaient présentées, est-ce que vous ne savez pas qu'une fille de onze ans a des jambes plus grandes qu'une fille de quatorze ans ? Et puis, cette fille n'a jamais porté de chaussures, si bien que ses pieds n'ont jamais cessé de grossir. Avant que vous ne me preniez tout mon argent pour emmener cette fille à Pendleton, je vous prie, monsieur, de bien vouloir aller vous-même (ou bien envoyez quelqu'un) interroger ma belle-sœur, madame Frazier, qui habite sur la propriété de monsieur Brissle (5) , à la Cumbahee, pour lui demander si cette fille Élizabeth, dont je suis la grand-mère, a plus de onze ans. | ||||
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Note ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___Whene'er he heard a tale of woe
___From client A or client B,
___His grief would overcome him so,
___He'd scarce have strength to take his fee.
dont Gonzales paraphrase les deux derniers vers (il a aussi repris l'expression a tale of woe comme titre d'un autre récit). Gilbert est connu par ailleurs pour avoir écrit les livrets d'une quinzaine d'opéras.
Ⓑ La phrase se termine par Gawd duh de man w'at gib de greese ; le sens général est clair (la graisse animale étant un symbole de la richesse et du plaisir), mais le détail l'est nettement moins, en particulier pour le rôle grammatical de w'at .
Annexe - De uino uetere nouisque amphoris | Old wine - new bottles (pages 271 à 275) |
Cette annexe est née des sentiments contradictoires venus à la lecture du dernier récit - l'un des plus accomplis, des plus forts du point de vue littéraire, mais poisseux de la nostalgie de l'ante bellum , du temps des Maussuh. D'où cette cotte mal taillée d'une traduction en latin.
Spartanburgi (1) uiuebat, et animosus cuiusdam iuuenis medici minister erat. Siue eius uultus nigrum colorem respiciens siue domini artem, aliqua sollers mulier illum « mortis umbrae uatem (2) » appellauit. Nescio, sed opinor hoc omnibus eius familiaribus maxime idoneum uisum esse. Vnde uenisset, nemo dicere poterat. Quodam die, in urbem errauit, rubrum Superioris Regionis uiarum puluerem in capitis lanitio ferens et Gullah litorosi sermonis uerbis utens, atque laborem quaesiuit. Etsi tantum tredecim annos natus, tamen lacertorum toris et uellicatâ facie uidebatur illum labores famemque nouisse. « Auos me feriit, abii, istum reliqui » – nihil aliud dixit ; cum autem industrium et probiorem se praeberet, nemo plura de peractis rebus inquisiuit. Quodam die, paulo postquam se in suum Spartanburgensem sacrarium constiterat, cum Imam Regionem inuiserem, mihi accidit ut aliquid de illius historiâ discerem. Cum terras transirem quae olim excelsae austrinae Carolinae gentis fundus fuerant, sed nunc a paucis Nigris occupabantur qui peioribus agriculturae modis paucissima ex uberrimâ tellure excerpere solebant, tum ad paupera aedicula ueni, aliquot centenos passus ab aliis aedificiis locata. Illic fuisse commoda materiaria domus, illarum simillima quae in australiensibus fundis ad Nigrorum insulas ante bellum aedificari solebant – materia autem multo ante igne deleta erat, et laterarius caminus solus exstabat. Inter litoris Nigros, quia lateres rarae sunt et plerique camini ex argillâ lutoue constitui solent, ei cui laterarius « chimbly » est maximâ reuerentiâ habetur, ut alicui nobili uiro in Nigrorum societate. Atque uetus Scipio Smashum, qui ante bellum domesticus famulus fuerat, et (per omnia impedimenta ad libertatem adsticta) rudiores « agrum (3) manus » contemnere pergebat, uitam diductam agere maluit ; itaque domum circum secretum laterarium caminum aedificauerat quae contra pluuiam, etiam recens, non perfecte tuebatur, sed tunc decrepita tristisque erat. […] Aediculorum uicina tam neglecta et sordida erant quam domus ipsa. Gramen Indum et malae herbae paene usque ad limen crescebant. Aliquot frumenti faseolique plantae cum herbis miscebantur ac paulo post sementes desertae erant. Saepti circumiacti scandulae cadebant et, per apertas partes, uicinorum boues suesque libenter ambulabant. In paruae caueae tecto, quidam iuuenis Dominicae gallus, dum comitem suam exspectat, interea grauiter clamabat – sed comes domesticis laboribus studebat. In scamno ad ianuam sedebat uetus Scipio. Lana quâ caput tegebatur tam candida erat quam Cotsuoldarum (4) ouium terga atque in facie maculosi flauique oculi alte impressi erant. Me adpropinquante, iactantem gallum obiurgabat : — Quam insolens es ! Vbi primum uxor tua in nidum uenit, tantum clamare incipis quantum deceat si tibi labor sit, neque illi. Hic stas, tergo maculoso, ut aliqui rubro capite picus ; puto autem te superbius ouum istum spectare quam ipsa gallina. — Salue, domine, Deo gratias ago, te hodie uideo. Tempora tam acerbissima sunt, domine ; nisi celeriter aduenisses, non ueterem Nigrum tuum hic inuenisses, ut opinor. Credo enim magnum Dominum me mox uocaturum, quia miseriarum in tergo aceruus peior fit, et cibus tam rarus in his diebus est, nec palae manubrium tenere possum ut olim poteram, neque ulla bos aut mulus mihi est ad solum arandum ; itaque nequeo iugera serere ; etiamsi quid sati crescere coepit, mihi nullus est puer aut alius qui squalores remoueat. Paene credo, nisi hodie ueneris, fore ut Stepney (5) hoc miserum uetus corpus habeat. Res aduorsae accederunt simul atque abiuistis, tam uerum quam Deus ! Iste puer Joe effugit et in Superiorem Regionem discessit, tantummodo quia eum uerberaui, et statim abiit. Vetus Sancho Heyuard (6) uxor interiit, et Sancho uenit et neptem meam, Mariam, abstulit quam uxorem duceret. Censebam illum ueterem Nigrum sapientiorem ; sed ubi cum personâ conuersari solitus sum, intellexi istum pro sano uiro non habendum esse. — Quando eius uxor periit ? interrogaui.— In februario interiit, domine. Cenam parabat, et ad arcam processit salem captum, quem in pulticulam funderet. Sed illi morbus in oculis fuerat neque clare uidere poterat ; credidit se salis pyxidem capere, sed re uerâ caustici pyxidem cepit, et causticum in pulticulam fudit ; quae primum cognouit ? nihil cognouit quia mortua est ! O certe, domine, illi religio paulo ante mortem data est, et illi puchra mors fuit, certe, domine, et illi quam honestissimae exsequiae tributae sunt, et uetus Pa Sancho coniugem suam in terra locauit ut hodie fieri solet ; uerumtamen (Deo placuit), cum ab exsequiis domum reueniret illo eodem die, per aedes meas iter fecit et nepem meam Mariam cepit et eam secum abstulit ut uxorem ! Si domi adfuissem, istum non uirginem auferre siuissem nisi peracto mense ; quod decentius uisum esset, certe, domine. At mihi nulla de Sancho cura est ; uirgo enim sic faciet ut Sancho putet eam a fulmineâ uiperâ captam esse, ante huius anni finem, certe, domine. Isti dixi : « Sancho, sapientior eras ! Caueamus potius quam ueniam impetremus ; Pauli quoque uerbis ad Barabbam (7) in Scripturis plane significatur te iuuene uinum in antiquam amphoram non fundere posse ; neque potes iuuenem mulierem in ueteris mulieris tunicam insinuare, quia ambae discindentur. Sancho, clarissime cognosti te non ualiturum esse, neque tibi fore uim quâ istam iuuenem uxorem ferires ; et cognosti Barabbam haec dixisse : nisi uxorem ferieris, istius filias filiosque putridos facies. » Sed pro Deo profiteor, domine, ista uirgo Patrem Sancho insanum efficiet, neque umquam habet consilia mea in ullo capitis sinu ! Nunc autem, uirgine profectâ, nemo est qui quicquam mihi faciat. Istis Nigris, qui postquam libertas accedit adoleuere, nulla est disciplina ; me siuissent mori in his aedibus nisi quidam Albi me animaduertissent. Vbi uetus Domina uiuebat, Deo gratias ago, semper ueteris Nigri meminerat ; nunc uero, illâ mortuâ et herbis (illic sub uiuis quercibus) in sepulcro crescentibus, et omnibus Albis quos magni aestimabam antiquos agros relinquentibus perque terram omnem diffugientibus, et quibusdam contemnendis Albis, qui olim cum his albis gentibus uersari nolebant, eadem ipsa loca occupatum uenientibus, Deo placuit, non multa mihi sunt nunc hodie quare uiuam. Tibi gratias ago, iuenis domine, gratias ago, domine. Vtinam Deus tibi faueat ! |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Note ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| valet (réalité) | Placer le curseur de la souris dans cette case pour afficher le jeu de mots the valet of the shadow of death |
| valley (ressemblance phonétique) | the valley of the shadow of death (psaume 23, verset 4, texte de la King Jame's Version ) |
Louis Segond traduit l'expression biblique (tirée du psaume attribué à David et dont les premiers mots sont
Le Seigneur est mon berger ) par la vallée de l'ombre de la mort , ce qui permet un jeu de mots comparable en français :
le valet de l'ombre de la mort .
Malheureusement, il en va différemment en latin. La Vulgate traduit l'expression par in valle mortis ; or
- s'agissant de la forme, le seul homophone approximatif est uallum/uallus , qui désigne un poteau ou une palissade ;
- pour le sens, le terme correspondant le mieux à valet est minister (la notion de valet , liée à celle de vassalité, est caractéristique du Moyen Âge) ; on pourrait à la rigueur penser à famulus ou cliens ; mais rien qui se rapproche phonétiquement de uallis . D'où le recours à uates , le devin ou l'oracle - comme pis-aller.
Quant à la métaphore du nouveau vin dans de vieilles bouteilles, elle n'est pas de Paul mais de Jésus lui-même, et ne se trouve que dans les évangiles : Matthieu, 9:17 ; Marc, 2:22 et Luc, 5:37.
Plan du site & Mentions légales_._Site éclos sur Skyrock, développé avec Axiatel et mûri sur Strato.com_._© 2015-2025 - XylonAkau


